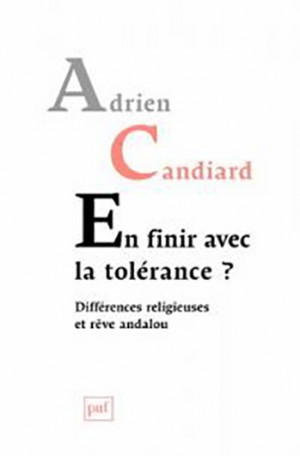Titre
En finir avec la tolérance ?Sous titre
Différences religieuses et rêve andalouAuteur
Adrien CandiardType
livreEditeur
Presses Universitaires de France, janvier 2014Nombre de pages
92Prix
12 €Date de publication
26 février 2014En finir avec la tolérance ?
Adrien Candiard, frère dominicain, est né en 1982. Il est membre de l’Institut dominicain d’Études Orientales (IDEO) au Caire. Ancien élève de Normale Supérieure (Ulm) et de Sciences-Po Paris. Il est l’auteur de la pièce de théâtre « Pierre et Mohamed », consacrée à Pierre Claverie, évêque d’Oran, assassiné en 1996 avec son chauffeur, et jouée pour la première fois, en 2011, en Avignon.
Il retrace dans cet ouvrage, qu’il qualifie d’ « essai », les origines du concept occidental de tolérance, qui s’est forgé à partir de la philosophie des Lumières, et s’interroge sur son échec à permettre aujourd’hui un dialogue serein entre raison, culture, et religions. Il propose, en s’inspirant de ce que fut en réalité, et non selon la légende, le très actif dialogue interreligieux dans l’Espagne médiévale, un nouveau concept de tolérance, qui concilierait respect des différences religieuses et recherche commune – avec intelligence et raison – de la vérité.
Cet ouvrage qui aborde la question posée sous l’angle de l’histoire, mais aussi en évoquant les œuvres de philosophes ou de théologiens, reste d’une lecture très accessible par le report en notes – toujours éclairantes – des références historiques et bibliographiques nécessaires. A côté de l’évocation des figures historiques de l’Espagne andalouse ou de la pensée occidentale, que l’auteur resitue avec à-propos dans leur contexte social et religieux, apparaissent quelques acteurs des controverses interreligieuses médiévales moins connus, tels le « touche à tout » Ibn Hazm de Cordoue[1] et l’étonnant Raymond Lulle[2] de la cour d’Aragon, « féru d’amour courtois et de jolies femmes », dont le rôle et la vie – parfois fort mouvementée – sont retracés de manière extrêmement vivante.
L’argument d’A. Candiard est que, telle qu’elle s’est progressivement constituée en Europe aux 17ème et 18ème siècles, à partir des contributions des philosophes Locke, Spinoza et Kant, la notion de tolérance a eu pour rôle essentiel de tenir à l’écart la violence qui y avait fait rage pendant les guerres de religion. L’apport des Lumières, en postulant la neutralité de l’Etat devant les diverses religions, et en renvoyant la religion à la vie privée, est à la base de nos concepts de laïcité et de sécularisation, souligne A. Candiard. Cette opération s’est toutefois effectuée au prix du retrait des questions religieuses du domaine de l’intelligence et de la raison. La foi ne relève plus d’un débat public car elle relève désormais, en Occident, du « croire », et non plus du « comprendre ». Les risques n’en sont pas minces : privée de son cadre rationnel, la pensée religieuse devient au mieux une opinion privée qui fait l’objet d’une indifférence polie. Et plus souvent encore, elle devient une question identitaire, propice aux sectarismes comme aux crispations qui peuvent affecter aujourd’hui chrétiens et musulmans. Pour A. Candiard, notre concept de tolérance semble désormais inopérant pour dépasser les incompréhensions et les craintes que le fait religieux musulman soulève, en particulier dans nos pays d’Europe.
C’est là que la référence à l’Andalousie de l’Espagne médiévale lui paraît féconde. A condition toutefois de ne pas se satisfaire du mythe selon lequel cette Espagne andalouse aurait déjà vu fleurir une tolérance du type de celle des Lumières. La coexistence, parfois conflictuelle, des religions n’y était pas fondée sur une privatisation de la foi, le relativisme ou le syncrétisme. Évoquant les grandes figures qui ont marqué la philosophie andalouse puis le débat médiéval entre chrétienté et monde musulman, A. Candiard montre que l’Andalousie fut le lieu d’une confrontation intellectuelle de haut niveau, où la « dispute » philosophique soulevait parfois autant de passion qu’un match de boxe ! De part et d’autre l’on déploya beaucoup d’énergie et d’intelligence pour rechercher la vérité et la faire partager. La volonté de connaître la pensée de l’autre, pour en débattre, fut à l’origine d’un vaste mouvement de traductions, et d’un ensemble de controverses hautement argumenté. Et au delà d’inévitables aspects polémiques, il n’y manquait ni le respect de l’autre, ni la reconnaissance de ses différences.
Citant l’intuition du Père Pierre Claverie : « il faut dialoguer par les différences », et avec sans aucun doute, en arrière-plan, l’expérience que lui donne en cette matière son activité à l’IDEO du Caire, A. Candiard souligne les conditions d’un dialogue interreligieux authentique. Elles passent par le travail et la connaissance de l’autre, par l’usage de la raison comme « terrain commun de notre identité unique », et par le débat qui est signe de respect, car « mon interlocuteur est toujours mon égal ». C’est ainsi que sera possible la construction d’une société dont la laïcité ne se confondra plus avec l’exclusion de l’expression religieuse du domaine public, mais où « l’affirmation par tous (croyants ou non) de convictions fortes et fondées en raison » sera désormais le fondement solide de la tolérance.
Voici un livre que la confiance de son auteur dans la force de la raison et dans le rôle positif du débat respectueux rend extrêmement tonique. Il est construit sur un va-et vient entre l’histoire de la pensée, la présentation d’étonnantes figures de l’époque médiévale et des grands auteurs de l’Europe des Lumières, et une réflexion sur nos contextes et enjeux sociaux les plus actuels.
Pour tous ceux qui se sentent concernés par le dialogue interreligieux dans nos sociétés occidentales et au Moyen-Orient, et par l’articulation entre laïcité et expressions religieuses, il est à la fois extrêmement stimulant et réellement captivant.
Bertrand Wallon