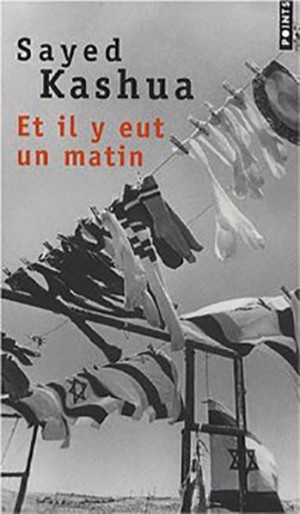Titre
Et il y eut un matinAuteur
Sayed Kashua ; trad. de l’hébreu par Sylvie Cohen et Edna DegonType
livreEditeur
Ed. de l’Olivier, 2006 | Rééd. Points, 2008Collection
LittératureNombre de pages
288 p.Prix
7,30 €Date de publication
10 janvier 2016Et il y eut un matin
La réussite des romans, écrits en hébreu, de Sayed Kashua, arabe de nationalité israélienne (Tira, le village où il est né est devenu israélien en 1948), né en 1975, tient à la singularité de son point de vue, d’un humour ravageur, d’une lucidité désespérée, tant sur la société arabe que sur la société israélienne. Il est chroniqueur du quotidien Haaretz et auteur d’une série télévisée très médiatique, Travail d’Arabe, où il se moque des Juifs et des Arabes, et surtout de lui-même, en héros qui tente maladroitement de s’intégrer à la société israélienne sous l’œil hilare de sa femme et de ses deux enfants. Déjà un premier roman, Les Arabes dansent aussi, avait été salué par la critique israélienne et internationale pour le récit satirique et saisissant qu’il faisait du parcours initiatique d’un jeune garçon issu de la minorité arabe d’Israël, rejeté à la fois par les siens et par ses pairs juifs.
Dans Et il y eut un matin, le narrateur, qui n’a pas plus de nom que dans certains romans de Kafka, est l’un des rares reporters arabes à travailler pour la presse israélienne, un job décroché « grâce aux accords d’Oslo ». Mais depuis la seconde Intifada, il se sent toujours plus précarisé au sein d’une société israélienne qui lui a toujours fait sentir sa différence, et qui prend tous les arabes pour des terroristes. Relégué par la direction du journal au rang de pigiste, angoissé par cette situation d’insécurité, il quitte la ville et revient avec femme et enfant dans son village d’enfance, en Galilée, auprès de ses parents, dans la maison qu’ils aménagent pour eux tout à côté : « Je me disais que la vie serait beaucoup plus facile si tout le monde était comme moi. »
Mais la vie au village se révèle être cauchemardesque à cause du conservatisme de la société arabe, de sa misogynie qui n’accepte pas les femmes dans un bar, de la servilité des adultes et de l’hystérie des jeunes, dont la distraction consiste à circuler en voiture à tombeau ouvert avec la musique à fond. Un matin, l’armée israélienne encercle sans explication le village et la situation s’aggrave. Les soldats tuent des villageois et deux des travailleurs palestiniens que le maire du village décide d’expulser hors du village, pour montrer sa bonne volonté aux Israéliens. L’eau et l’électricité sont coupées, la pénurie alimentaire menace, les ordures s’entassent, les égouts se bouchent. À la radio, on fait silence sur les événements, tandis que les discours officiels évoquent des négociations en cours entre Israéliens et Palestiniens. Les esprits s’échauffent. Le narrateur, qui a été agressé par des voisins réclamant de la nourriture, rêve de pouvoir retourner dans un quartier juif d’une ville juive : « Même si on y a vécu l’enfer, on ne nous a jamais attaqués, pas physiquement en tout cas ».
Lorsque, tout aussi soudainement, l’électricité revient et l’armée part.
Nous laissons aux lecteurs le plaisir de découvrir la fin de cette histoire, à la fois drôle et tragique, qui utilise l’utopie espérée de la paix entre Israël et la Palestine pour parler de l’identité malheureuse des Arabes – « Je sais qu’on déteste les Arabes partout dans le monde et qu’il n’y a pire malédiction que d’être arabe aujourd’hui » – et pour donner une voix aux Arabes Israéliens, ignorés de tous.
En 2010, un troisième roman, La deuxième personne, racontait encore, avec un humour noir, la schizophrénie quotidienne de l’Arabe israélien.
En juillet 2014, Sayed Kashua a décidé de quitter Israël pour partir vivre avec sa famille aux États-Unis, en Illinois, regrettant, dans les colonnes de Libération, qu’« une majorité désespérément déterminante dans le pays ne reconnaît pas à l’Arabe le droit de vivre, en tout cas pas dans ce pays. »
Quant à nous, lisons donc Sayed Kashua, écrivain arabe et citoyen israélien !
Pascale Cougard