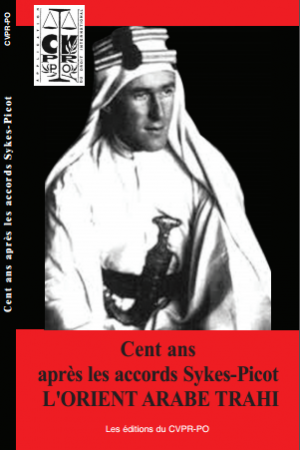Titre
L’Orient arabe trahiSous titre
Cent ans après les accords Sykes-PicotAuteur
Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-OrientType
livreEditeur
CVPR-PO, 2016Nombre de pages
128 pagesPrix
10 €Date de publication
25 novembre 2017L’Orient arabe trahi
Ce petit livre rassemble les contributions d’une quinzaine d’intervenants : historiens, professeurs, diplomates, spécialistes du monde arabe, politologues, militaires… pour faire le point sur la situation géopolitique du Proche-Orient d’aujourd’hui[1]. Ce n’est donc pas un livre d’histoire sur les accords cités en sous-titre : le centième anniversaire n’est qu’un prétexte pour en analyser les conséquences pour les Etats et les peuples. Sur le fait lui-même, les historiens intervenants n’ont pas insisté : il faut attendre la contribution écrite ultérieure d’un participant[2], placée en annexe, pour comprendre le contexte économique, sociétal et politique dans lequel, en pleine guerre mondiale, l’Angleterre et la France se sont approprié des territoires de l’Empire ottoman défaillant.
A cette réserve « objective », on ajoutera que la tonalité militante de certains propos sur le conflit Palestine/Israël, ne fait guère avancer l’analyse de la situation. Dénoncer l’autre, même avec force et raison (l’Occident, le sionisme…), c’est accepter d’entrer dans la logique du combat entre le Bien et le Mal, cette même logique des Américains (George Bush)… ou de Daesh !
Heureusement, au fil des conférences et des questions-réponses dans le dialogue avec le public, les analyses deviennent plus pertinentes et le lecteur va trouver de quoi alimenter sa réflexion ou conforter ses convictions. Impossible de résumer ici la richesse de tous ces apports successifs, très divers et couvrant de larges perspectives.
Quelques échantillons significatifs suffiront pour s’en faire une idée.
Il est question plusieurs fois de « mythe », de « fantasme » et de « rêve ». Mythe d’une intervention occidentale, rêve de l’unification du monde arabe jamais atteinte. Mais bien avant 1916, le Proche-Orient s’était déstabilisé lui-même, travaillé par les nationalismes et les pouvoirs économiques de la société du capitalisme international. Il est à noter que les accords Sykes-Picot ignorent complètement la Palestine. L’un des intervenants conteste d’ailleurs le mot « trahison » de l’intitulé du colloque. Pour lui, c’est une catégorie morale qui masque une dynamique perverse de la recherche du pouvoir.
Qui est ce pouvoir ? Celui de l’Occident modernisé, celui de la Turquie ottomane, celui des élites arabes. Plusieurs contributions insistent, avec plus ou moins de nuances, sur l’affrontement de ces trois puissances. L’Occident, le plus extérieur, est dans la logique coloniale de l’époque (comme le sionisme à ses débuts,) et il est obnubilé par les ressources pétrolières, l’Angleterre devançant largement la France dans ce domaine, mais toutes deux écartant la Russie et ne tenant pas compte d’une Amérique pas encore en guerre. Moins connu, le pouvoir turc va pourtant être un acteur essentiel, soit par son absence (avec l’empire ottoman), soit par la violence de la dictature future d’Atatürk[3]. Un conférencier voit la résurgence du héros turc dans un Erdogan d’aujourd’hui : même ambition, même avidité du pouvoir, mêmes méthodes d’élimination des opposants, avec l’hypocrisie de la laïcité en moins… Et puis, les élites arabes, rois, princes ou présidents, qui vont s’entre-déchirer pour un leadership qu’aucun ne saura exercer, sauf, brièvement, Nasser.
L’un des diplomates invités aura une intéressante réflexion sur les notions d’état, de démocratie, de nation, d’appartenance, et sur les trois nationalismes qui s’affrontent au Proche-Orient : le turc, l’israélien, l’arabe. Il s’interrogera sur le manque de régulation internationale par l’ONU, signalant au passage le paralysant droit de véto du Conseil de Sécurité aux mains des vainqueurs de 1945. Il estimera que, vu la situation, « il serait imprudent aujourd’hui de revenir » sur les accords de 1916.
Inévitablement, avec l’apparition de Daesh sur la scène mondiale, se pose la question de la religion. « De quoi Daesh est-il le nom ? » C’est plutôt un mouvement colonialiste qui se sert du fantasme religieux du califat pour s’attribuer un pouvoir et un territoire. Il est dans la mouvance « du sionisme qui, athée au départ, instrumentalise la religion à des fins politiques ». Plusieurs intervenants reviendront sur cette affirmation : la religion n’est qu’un trompe-l’œil d’une situation qui relève essentiellement du domaine politique.
Bien d’autres pistes restent à découvrir, par des lecteurs déjà un peu avertis sur la situation du Proche-Orient aujourd’hui. Il faut lire en particulier la longue liste des interventions occidentales, surtout américaines, depuis 1990, pour mieux comprendre le chaos engendré : destruction de l’Irak et de la Syrie, abandon de la Palestine, le problème kurde comme une poudrière, l’hostilité à peine voilée entre l’Iran et les Etats Arabes du Golfe. Si les accords de 1916, suivis du traité de San Remo en 1920, sont passés inaperçus à leur époque, nul doute qu’ils marquent, dans l’imaginaire des peuples, le temps de la Nakba, de la catastrophe. Ces mêmes peuples, à qui on n’a jamais rien demandé, sinon que de subir la volonté de puissance des autres, turcs, occidentaux, israéliens… ou arabes.
On sort de ce livre, un peu abasourdi par l’ampleur des problèmes, mais plus averti, moins « enfumé », plus lucide.
« Comprendre la réalité est un impératif plus que catégorique » concluait le dernier intervenant. Ce colloque de 2016 est une contribution de plus à cette compréhension.
Claude Popin
[1] Cf. Programme et liste des intervenants du colloque du 8 octobre 2016 organisé au Palais du Luxembourg par le CVPR-PO.
[2] Bernard Cornut, polytechnicien et chercheur en géopolitique et en histoire.
[3] Cf. Livre de Fabrice Monnier : Atatürk : naissance de la Turquie moderne .-CNRS éditions, oct. 2017.