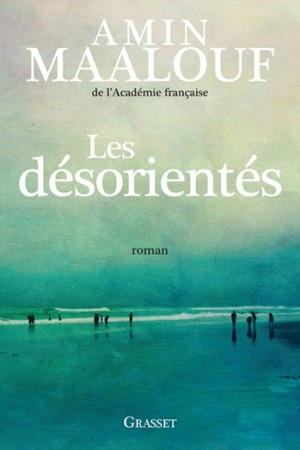Titre
Les désorientésAuteur
Amin MaaloufType
livreEditeur
Grasset, septembre 2012Collection
Littérature françaisePrix
22€Date de publication
12 novembre 2013Les Désorientés
« L’histoire des nôtres, de nos familles et de notre bande d’amis, celle de nos illusions et de nos égarements, n’est pas inintéressante à raconter parce qu’elle est un peu aussi l’histoire de notre époque, de ses illusions, justement, comme de ses égarements » dit un des personnages du dernier roman d’Amin Maalouf dont le regard lucide et sensible s’inscrit dans l’actualité chaotique de notre temps.
Dans Les désorientés, au titre particulièrement bien choisi, l’écrivain émigré revient sur « les guerres » du Liban, dont les séquelles semblent ne jamais pouvoir finir, causes de son exil en France. Ce roman nostalgique et doux-amer inspiré par le parcours de son auteur né à Beyrouth en 1949, met en scène, à travers plusieurs voix narratives, une bande d’amis qui avaient vingt ans à la veille de l’explosion de leur pays – qui n’est par pudeur jamais nommé – au milieu des années 70 et rêvaient de construire un monde pacifique, uni dans la diversité. En l’an 2001, temporalité du roman, ils peuvent dire, comme le personnage principal : « Nous sommes de tous les Juifs et de tous les Arabes les plus tristes et les plus désemparés. »
Adam, exilé en France depuis une trentaine d’années, est devenu historien spécialiste de l’époque romaine. Il prépare une biographie sur Attila qui est pour lui « l’archétype de l’immigré » : «L’Europe est pleine d’Attilas qui rêvent d’être citoyens romains et qui finissent par se muer en envahisseurs barbares ». Il a été éduqué chez les pères jésuites et appartient donc à la communauté minoritaire chrétienne, mais il se déclare ni adepte d’une religion, ni athée, il est « entre la croyance et l’incroyance comme (il) est entre (ses) deux patries, caressant l’une, caressant l’autre, sans appartenir à aucune ». Il s’en retourne pour la première fois vers le pays où il est né : Mourad, l’ancien ami d’enfance dont il s’était éloigné en raison de son comportement durant la guerre, se meurt et le réclame. Il arrivera trop tard. Mais il séjourne chez son amie Sémiramis, émigrée venue d’Égypte, dans un hôtel de la montagne, près de la capitale, et il tient un journal où il explore, durant seize jours, à la fois le passé et le présent de son retour momentané au pays. Avec la rationalité de l’historien il va s’interroger sur ses émotions et ses réminiscences à l’aide de documents, de lettres, de coupures de presse et de photos.
Le constat est désenchanté dès le début du livre qui évoque « l’inutile pèlerinage » du narrateur émigré: « Je porte dans mon prénom l’humanité naissante, mais j’appartiens à une humanité qui s’éteint » écrit Adam qui va évoquer son paradis perdu, cette « civilisation levantine » multiconfessionnelle ayant volé en éclats sous les assauts de guerres embrasant le Moyen Orient de façon inextricable. Il dit aussi : « de la disparition du passé, on se console facilement ; c’est de la disparition de l’avenir qu’on ne se remet pas. Le pays dont l’absence m’attriste et m’obsède, c’est celui dont j’ai rêvé, et qui n’a jamais pu voir le jour. »
Mais Adam n’en démordra pas : « On ne cesse de me répéter que notre Levant est ainsi, qu’il ne changera pas, qu’il y aura toujours des factions, des passe-droits, des dessous-de-table, du népotisme obscène, et que nous n’avons pas d’autre choix que de faire avec. Comme je refuse tout cela, on me taxe d’orgueil, et même d’intolérance. Est-ce de l’orgueil que de vouloir que son pays devienne moins archaïque, moins corrompu et moins violent ? Est-ce de l’orgueil ou de l’intolérance que de ne pas vouloir se contenter d’une démocratie approximative et d’une paix civile intermittente ? Si c’est le cas, je revendique mon péché d’orgueil, et je maudis leur vertueuse résignation ». Et encore « C’est moi qui ai raison, et c’est l’Histoire qui a tort ! »
Pris entre fierté, joie de se « sentir sur sa terre natale » et tristesse, tout en reprenant contact avec les amis restés, il échange par courrier électronique avec les amis émigrés afin d’organiser une rencontre de retrouvailles à l’occasion du quarantième jour suivant les funérailles de Mourad. La trame narrative, palpitante, raconte les péripéties diverses vécues par chacun des amis, constituant une méditation dialoguée autour de quelques interrogations récurrentes dans l’œuvre d’Amin Maalouf : pourquoi cette crispation sur les identités religieuses ? Pourquoi « la voix sage » de la réconciliation, qui est celle de la génération d’Adam, est–elle devenue aussi inaudible ?
Adam va retrouver tout son cercle d’amis de l’Université, le « club de Byzance », à l’exception de Bilal, « l’être pur » devenu milicien pour imiter les héros de ses lectures dès le début de la guerre, mort sans avoir tiré un coup de fusil.
Sous le feu des événements, chacun a dû faire son choix entre rester ou partir, « entre deux fidélités inconciliables ; ou, ce qui revient au même entre deux trahisons ».
Certains amis sont partis en Europe ou en Amérique.
Ainsi Albert, qui n’a jamais pu dire à ses amis qu’il était homosexuel, après avoir désiré se suicider et avoir été sauvé paradoxalement par un ravisseur preneur d’otage au début de la guerre, est-t-il parti aux États-Unis où il travaille dans un think-tank comme expert en « futurologie » à Indianapolis. A travers son personnage et celui des deux femmes du roman, Sémiramis, restée célibataire après la mort de son amour de jeunesse Bilal, avec laquelle Adam va avoir une relation amoureuse, et Dorothée la compagne argentine d’Adam, le roman aborde la question de la liberté individuelle, celle des corps et des cœurs.
Ainsi Naïm, dont le père Moïse a eu dans sa jeunesse les mêmes rêves de coexistence entre toutes les communautés, a-t-il accepté de partir avec sa famille au Brésil, ce bout de Nouveau Monde dont il a fait sa véritable « terre promise ». C’est que le conflit autour de la Palestine influe sur le sort des Juifs dans les sociétés arabes et les place dans une impasse : « Comment cesser d’être un agneau sans devenir un loup ? La voie suivie par les Israéliens ne me convainc pas, mais je n’ai pas d’alternative à leur proposer. Alors je m’éloigne, je me tais et je prie » disait le père. Le fils complète : « Nous sommes à l’âge de la mauvaise foi et des camps retranchés. Qu’on soit juif ou arabe, on n’a plus le choix qu’entre la haine de l’autre et la haine de soi. Et si tu as le malheur d‘être né, comme moi, à la fois arabe et juif, alors tu n’existes tout simplement pas (…) tu n’es qu’un malentendu, une confusion, une méprise, une fausse rumeur que l’Histoire s’est déjà chargée de démentir ». Persuadé que le rôle historique de la communauté juive est d’être un « ferment humaniste global » Naïm pointe le paradoxe de l’État d’Israël : « On ne peut pas être à la fois farouchement nationaliste et résolument universaliste. »
En écho à ces questionnements, pour Adam, le « conflit autour de la Palestine » « empêche le monde arabe de s’améliorer », « empêche l’Occident et l’Islam de se réconcilier », « tire l’humanité contemporaine vers l’arrière, vers les crispations identitaires, vers le fanatisme religieux, vers ce qu’on appelle de nos jours `l’affrontement des civilisations’ » et « c’est d’abord à cause de ce conflit que l’humanité est entrée dans une phase de régression morale, plutôt que de progrès. » Ou encore « Le conflit avec Israël a déconnecté les Arabes de la conscience du monde, ou tout au moins de la conscience de l’Occident, ce qui revient à peu près au même ». Tel est le cœur du livre, son regard sur le déséquilibre géopolitique mais aussi « clinique » et moral des rapports entre l’Occident et le Moyen-Orient.
À travers ces personnages et celui du narrateur Adam, le roman est aussi une méditation sur les ambivalences de l’exil. L’exil comme perte d’un paradis, dont les hommes sont chassés, soit à cause d’une faute, soit à cause d’un accident. Adam, orphelin à 13 ans, constate qu’il s’est depuis « toujours senti partout un invité. Constamment dissemblable, mal ajusté – mon nom, mon regard, mon allure, mon accent, mes appartenances réelles ou supposées. Incurablement étranger. Sur la terre natale comme plus tard sur les terres d’exil ». On le voit bien dans les efforts qu’il fait pour vivre au quotidien dans un pays qu’il a quitté depuis presque 30 ans. Mais, pour lui, partir en France n’a pas été un arrachement car il se sent habitant de la planète Terre : « naître, c’est venir au monde, pas dans tel ou tel pays, pas dans telle ou telle maison ». De la même façon l ‘ancien étudiant et ses amis se voulaient « voltairiens, camusiens, sartriens, nietzschéens ou surréalistes » et non chrétiens, musulmans ou juifs, un point de vue qui est aussi celui de la bourgeoisie libanaise cultivée des années 70, celle qui a eu les moyens de fuir la guerre et a donné à la France un écrivain connu, Amin Maalouf devenu académicien.
Si Adam s’est éloigné du Levant « pour essayer de garder les mains propres », Mourad et Tania ont fait le choix de rester. Or, pour récupérer sa maison familiale, Mourad a pactisé avec un collaborateur de l’occupant ; comme prix de sa compromission, il a non seulement retrouvé son bien familial mais il est devenu ministre pour de nombreuses années, trahissant ainsi, de façon inacceptable aux yeux d’Adam toutes les valeurs qui leur étaient communes. Piquée par le refus de ce dernier d’aller aux obsèques de Mourad, Tania soutient un tout autre point de vue sur l’exil : « la question n’est pas de savoir ce que toi tu aurais fait si tu étais resté. La question est de savoir ce que serait devenu le pays si tout le monde était parti comme toi. Nous aurions tous gardé les mains propres, mais à Paris, à Montréal, à Stockholm ou à San Francisco. Ceux qui sont restés se sont sali les mains pour vous préserver un pays, pour que vous puissiez y revenir un jour, ou tout au moins le visiter de temps à autre. » A cela Amin Maalouf répond, à travers le personnage d’Adam : « Tout homme a le droit de partir, c’est son pays qui doit le persuader de rester. »
Parmi ceux qui sont restés on trouve aussi Nidal, le frère de Bilal, devenu barbu islamiste. Malgré ses positions tout à fait différentes du groupe d’amis, il va être invité et va venir aux retrouvailles. Pourtant la rencontre avec Adam, au restaurant, ressemble à un règlement de comptes et si elle peut durer c’est parce que le lien affectif est fort. C’est en s’appuyant sur ce lien affectif qu’Adam peut argumenter en historien qu’il est : sur la débâcle historique de la civilisation levantine, sur « l’esprit du temps » que nous suivons tous, d’une manière ou d’une autre, et sur l’idée de révolution qui après avoir été l’apanage des progressistes, a « été captée par les conservateurs » « entre l’été 1978 et le printemps 1979 ». Une façon de dire à Nidal qu’il est devenu « un fieffé rétrograde » par son adhésion aux interdits vestimentaires et alimentaires des groupes islamistes.
Enfin, dans ce monde mis à feu et à sang sous prétexte de religions, à travers les choix des deux amis, Ramez et Ramzi, que tout le monde appelait « les Ramz » tant ils étaient unis, le roman aborde la question du sens et de la fragilité de la spiritualité dans un monde ravagé par l’idéologie capitaliste.
Si Ramez est resté l’ingénieur richissime qui a établi sa luxueuse résidence à Amman et parcourt en avion le Moyen Orient, son ami associé Ramzi a changé brusquement. Bien qu’il ait lui aussi amassé une grosse fortune en construisant des palais, des tours, des prisons ou des bases militaires, il a tout abandonné pour se retirer dans un monastère de la montagne, sous le nom de frère Basile. Il a restauré la chapelle troglodyte ornée de fresques religieuses médiévales, construit un labyrinthe de méditation et vit dans une austère communauté de neuf moines qui veillent à garder un contact de services avec le village où ils participent à la messe dominicale. Ils sont venus de Tyr, Mossoul, Haïfa, Alep et Gondar. Ils pourraient dire, s’ils avaient le goût de la vantardise « Nos ancêtres étaient chrétiens quand l’Europe était encore païenne, et ils parlaient l’arabe bien avant l’islam ». Mais, quand Adam, venu passer deux jours avec eux, les questionne sur l’avenir de leurs communautés chrétiennes respectives, ils répondent « Je prie, mais je n’ai pas d’espoir. »Et lorsqu’Adam fait résonner l’interrogation du Christ au moment de sa passion, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », frère Basile lui répond : « Si tous les hommes sont mortels, nous, les chrétiens d’Orient, nous le sommes deux fois. Une fois en tant qu’individus – et c’est le Ciel qui l’a décrété ; et une fois en tant que communautés, en tant que civilisation, et là, le Ciel n’y est pour rien, c’est la faute des hommes. »
La bande d’amis est sur le point d’être reconstituée, le temps d’une rencontre pour donner sens à leur vie dont les récits ont commencé à se partager. Mais, pour conclure le roman, advient une fin représentative du désenchantement de l’auteur, symbolique aussi des nœuds tragiques entravant la bonne marche de l’humanité. Non pas un attentat, comme on aurait pu l’attendre, mais un accident de voiture sur la route sinueuse du monastère où Adam est venu chercher frère Basile pour l’amener au lieu de la réunion. Faisant de ce jour de retrouvailles le jour de l’ultime dispersion. Frère Basile est tué, Adam est plongé, entre la vie et la mort, dans un profond coma dont on ne sait s’il sortira, « en sursis, comme son pays, comme cette planète, comme nous tous ».
Entre douleur, colère, désillusion, nouvelles raisons de se battre et frémissement d’espoir, une fois encore la polyphonie romanesque incarne avec subtilité les questionnements pressants d’un écrivain. Amin Maalouf, point de rencontre des cultures et des religions, au carrefour de chemins venant de Turquie, d’Égypte, du Liban et d’Europe, au croisement fertile de trois langues, l’arabe, l’anglais et le français, s’interroge une nouvelle fois : comment construit-on son identité et comment transforme-t-on la mémoire dont on hérite en une pensée permettant d’humaniser et d’habiter le monde ?
Pascale Cougard