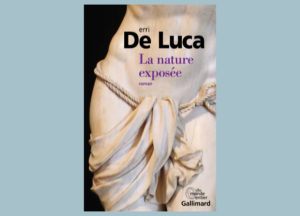Titre
La nature exposéeAuteur
Erri De Luca ; trad. de l’italien par Danièle ValinType
livreEditeur
Paris : Gallimard, 2017Collection
Du monde entierNombre de pages
165Prix
16,50Date de publication
20 août 2018La nature exposée
Le narrateur de ce beau roman est un modeste sculpteur de pierres ou de racines dans un petit village de montagne où depuis quelque temps des étrangers désorientés tentent de passer la frontière, une adresse en poche leur servant de boussole et parlant « des langues qui font le bruit d’un fleuve lointain ». Avec deux camarades d’enfance, ils ont créé un service d’accompagnateurs car la montagne est pleine de risques. Ils font payer bien sûr, mais, lui, rend l’argent une fois les étrangers passés de l’autre côté. Tout fonctionne bien, jusqu’au jour où l’un des étrangers, écrivain, raconte son aventure dans un livre ! Si l’aubergiste se réjouit de cette publicité, les camarades se vexent des façons d’agir du sculpteur. Au point que ce dernier décide de quitter les montagnes pour passer l’hiver dans une ville du bord de mer.
On croit que commence une seconde aventure lorsqu’il est embauché par le curé pour retrouver l’original d’une magnifique et impressionnante statue de Christ en croix, à laquelle il faut retirer le drapé afin de révéler la nudité qu’avait choisie le jeune artiste revenu de la Première Guerre mondiale, dans un après-guerre bouleversé avec lequel l’Eglise voulait être en résonance. Le sculpteur doit redonner au Christ en marbre sa « nature », c’est à dire son sexe d’homme, recouvert par pudibonderie dans les années 1920.
Le roman prend alors toute sa dimension d’une réflexion sur l’art et sur l’artiste qui s’implique dans sa quête de vérité et de beauté jusqu’à une totale mise à nu de lui-même. Le sculpteur ne se voit que comme un passeur : passeur de migrants de part et d’autre d’une frontière qui pour lui n’est pas naturelle (« Les frontières et les lois sont celles que les hommes inventent et détruisent. Il faut savoir jouer avec et prendre des risques lorsque cela s’impose. ») ; passeur de sensations et d’émotions, de bribes de vérité et d’instants privilégiés.
Avec le travail auquel il s’attache pendant tout un hiver, il se fait passeur de la force de la représentation d’un Christ entièrement nu, homme de douleur qui a revêtu les douleurs de l’humanité. S’attachant à tout comprendre du supplice vécu, pour mieux rendre la vérité de cette partie essentielle du corps qui porte, dans sa légère érection, « le jaillissement de vie qui s’oppose » à la mort, il se dénude lui-même et se prend pour modèle, découvrant que le jeune artiste avait lui aussi voulu connaître de l’intérieur la souffrance de la position. Une volonté d’imitation qui est au cœur de la spiritualité chrétienne, lui fait remarquer le curé en citant le célèbre traité du XVe siècle L’imitation de Jésus-Christ [1]: « Que me deviennent précieuses et désirables, en ton nom, toute épreuve et toute tribulation. »
Ainsi, réparer la statue du Crucifié, c’est se tenir du côté de toutes les victimes et l’art est alors une voie royale pour faire ressentir la compassion. Le sculpteur devant ce Christ éprouve un sentiment inédit qu’il n’a jamais éprouvé devant aucun corps nu, la miséricorde, c’est à dire le cœur ouvert à la misère. L’œuvre d’art suscite un sentiment intensifié : « il existe des livres qui font ressentir un amour plus intense que celui qu’on a connu, un courage plus grand que celui dont on a fait preuve. C’est l’effet que doit produire l’art : il dépasse l’expérience personnelle, il fait atteindre des limites inconnues au corps, aux nerfs, au sang. Devant ce moribond nu, mes entrailles se sont émues. Je sens un vide dans ma poitrine, une tendresse confuse, un spasme de compassion. J’ai mis la main sur ses pieds pour les réchauffer. »
La sculpture du Christ en croix nu et torturé renvoie plus que toute autre représentation à l’humanité souffrante : « La nudité fait vibrer les fibres les plus anciennes de la compassion. Vêtir ceux qui sont nus, est prescrit dans une des œuvres de la miséricorde étudiées au catéchisme[2] ». Ne dit-on pas d’un visage souffrant qu’il est « christique » ? L’art occidental de tout temps prend la figure du Christ souffrant – ou de la Pietà lorsque la mère des douleurs berce son fils mort – pour dire la misère humaine. Celle de la guerre, celle de la solitude dans les villes, celle des migrants, dont le Juif est l’archétype.
Cette figure juive qui hante l’écriture d’un auteur ayant appris l’hébreu pour pouvoir ruminer chaque jour avant le travail manuel un texte de la Bible, apparaît dans le roman sous la forme d’un rabbin. Il rappelle, un vendredi saint, quel fut le sort de son peuple : « Etre condamnés à mort nus. Tel fut le sort de mon peuple au siècle passé, dans le désert d’Europe. Dévêtus avant d’être tués : les assassins répétaient en automates les préparatifs de la crucifixion d’un juif. »
En effet le sculpteur progresse dans son travail à travers des échanges avec des personnages très variés et étonnants – un véritable échantillon de nos sociétés métissées : des dialogues avec le curé et un évêque latino-américain, le rabbin qui l’initie au forage dans les significations de la langue hébraïque et un ouvrier algérien immigré grand connaisseur du Coran qui lui offre le petit bloc d’albâtre, un bloc rare, dans lequel la « nature » va être sculptée ; une conversation qui revient tout au long avec son frère jumeau, mort lorsqu’ils étaient enfants, manifestant la présence vive des absents ; un échange avec un gardien du musée archéologique de Naples (la ville omniprésente dans l’imaginaire d’Erri De Luca) coiffé comme le buste d’Epicure, son philosophe préféré qui recommande de rester caché pour être heureux.
Comme le narrateur, Erri De Luca se présente avec une attitude et une apparence simples et discrètes et il assume le paradoxe d’utiliser la reconnaissance que lui amène son œuvre et son aura d’ouvrier lecteur quotidien de la Bible en hébreu. Sa langue n’évoque que ce qu’il sait d’expérience, à travers un travail quotidien et un engagement politique et écologique qui le conduisent parfois jusqu’en prison. Grand lecteur, voyageur et travailleur manuel solitaire, comme son héros sculpteur, Erri De Luca trouve sa place dans cette communauté qu’est l’espace de l’art, de la lecture et de l’écriture. Il y est sans aucun doute un témoin essentiel de notre temps.
Pascale Cougard
[1] L’Imitation de Jésus-Christ.- éd. du Seuil, 1979.- coll. Points. Sagesse ; n° 17.- 256 p.-7,80 €
[2] Cf. Evangile selon St Matthieu, ch. 25, 31-46