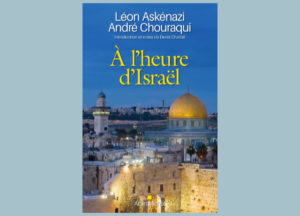Titre
À l’heure d’IsraëlAuteur
Léon Askénazi, André Chouraqui ; introduction et notes de Denis CharbitType
livreEditeur
Paris : Albin Michel, 09/05/2018Nombre de pages
218 p.Prix
17,50 €Date de publication
19 novembre 2018À l’heure d’Israël
Quand deux « phares » de la pensée juive française, André Chouraqui (1917-2007) et Léon Askénazi (1922-1996) – tous deux disparus aujourd’hui – se mettent à dialoguer sur le destin d’Israël et la création de l’État, il y a soixante-dix ans, le temps semble comme suspendu. Leur dialogue est un régal d’intelligence, de culture, de fraternité religieuse, de courage, d’humanité et d’humour aussi. Il ne date pas d’aujourd’hui, remonte à l’été 1987 à Jérusalem. Mais, trente ans après, l’éditeur Albin Michel a eu la bonne idée de le rendre public, accompagné d’une remarquable introduction signée de l’historien Denis Charbit[1].
Avant de s’enthousiasmer devant la réalisation de la promesse biblique et de l’utopie nationale sioniste, les deux hommes saluent la naissance d’Israël d’abord comme une … renaissance, inimaginable à échelle humaine, inconnue ailleurs dans le monde et le temps, d’une culture, d’une langue, d’un peuple, après trois mille ans de catastrophes, d’exils et d’exodes. Que la création d’Israël soit survenue juste après la Shoah est même, pour les deux hommes, le thème biblique par excellence, l’exacte application du plan de Dieu pour le peuple de la Promesse : « Dieu se souvient toujours des siens après que le peuple juif traverse une épreuve », souligne André Chouraqui.
Que cette re-naissance ait suscité tant de convoitises, de guerres et de haines, jusqu’à aujourd’hui, fait aussi partie de l’histoire biblique, de l’histoire de ce perpétuel « retour » du peuple juif. Toutes les sorties d’exil – Égypte, Assyrie, Babylone, Rome – ont produit des conséquences tragiques. Et les voisins arabes d’Israël ne se conduiraient pas autrement que les Cananéens ou les Jébuséens d’hier. La métamorphose d’un « judaïsme souffrant » en un « judaïsme triomphant » a aussi choqué les Églises chrétiennes qui ont mis du temps à reconnaître le nouvel État. Enfin, la « paix relative » qui a uni, pendant des siècles, les juifs et les musulmans, surtout en terre d’Orient, a éclaté à la suite de la création de l’État d’Israël.
Mais, malgré ce lourd passif, les deux hommes n’en perdent pas leur optimisme foncier, ni cette « estime de soi » inconnue du peuple juif, découverte avec la renaissance d’Israël, ni leur foi robuste dans la « normalisation » du Juif étranger, exilé, aujourd’hui citoyen israélien, dans les progrès du dialogue entre juifs et chrétiens, dans la proximité théologique, linguistique rituelle des deux monothéismes juif et musulman, dans le rêve d’une grande fraternité sémitique en Orient.
Soit, mais le malaise s’installe quand on referme ce livre. Comme cet optimisme d’André Chouraqui et Léon Askénazi, s’exprimant en 1987, paraît, trente ans après, daté et anachronique ! Le dialogue entre ces deux « géants » ignore bien sûr tout de la montée des extrémismes dans la région, des accords de paix avec les Palestiniens aujourd’hui réduits à néant ou presque, des menaces nouvelles pesant sur Israël, de la guerre perpétuelle à ses portes, au Liban, en Irak, en Syrie qui a détruit tout l’équilibre du Moyen-Orient, a tué tous les espoirs qui animaient ces deux hommes, en 1987, d’une cohabitation des peuples, des cultures, des religions.
Certes, A. Chouraqui et L. Askénazi ne sont pas des naïfs. Ils ne manquent pas de vision d’avenir. Ils évoquent déjà (superficiellement, mais comment peut-il en être autrement en 1987 ?) les risques d’une « judaïsation », à marche forcée, de la Cisjordanie. Mais comme on aimerait entendre aujourd’hui ces deux hommes face à la fièvre nationaliste et ultraorthodoxe qui démange de plus en plus Israël, face aux déviations du sionisme des origines, face à la récupération idéologique du messianisme religieux juif, face à la progression implacable des colonisations juives en Cisjordanie – comme à celle du Hamas à Gaza -, face à l’extrémisme des gouvernements Netanyahou. Les hommes passent, mais le temps ne s’arrête jamais. Pour le meilleur comme pour le pire.
Henri Tincq[2]
[1] Cf. Biographie et livres de Denis Charbit dont Israël et ses paradoxes : idées reçues sur un pays qui attise les passions
[2] Henri Tincq, ancien chef de la rubrique religieuse au Monde, chroniqueur à Slate et au Monde des religions, est l’auteur de nombreux livres dont la biographie de référence du cardinal Lustiger où « il raconte la vie extraordinaire d’un jeune enfant juif devenu cardinal-archevêque de Paris » (4e de couv.) :
Jean-Marie Lustiger : le cardinal prophète.- Grasset, 2012, et plusieurs livres sur les catholiques, cliquer sur : La grande peur des catholiques de France.- Grasset, 2018.