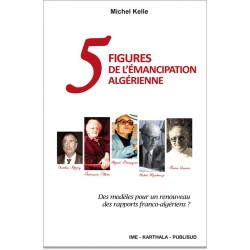Titre
Cinq figures de l’émancipation algérienneSous titre
Des modèles pour un renouveau des rapports franco-algériens ?Auteur
Michel Kelle ; préface d’Aïssa Kadri ; postface de J.-Ph. Ould-AoudiaType
livreEditeur
IME : Karthala : Edisud, 2013Collection
Hommes et sociétésNombre de pages
248 pagesPrix
20 €Date de publication
14 février 2017Cinq figures de l’émancipation algérienne
Ecrit pour le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, l’ouvrage présente cinq personnalités marquantes dont les parcours s’inscrivent entre 1934 et 1996, soit plus de 60 ans d’une histoire mouvementée : colonisation, seconde guerre mondiale, guerre de libération et difficile construction d’une nouvelle nation.
Michel Kelle, agrégé de grammaire et inspecteur pédagogique de français, a enseigné huit ans à Tlemcen et à Oran après l’indépendance[1]. A la manière dont il parle de ses cinq personnages, tous disparus, et de l’Algérie qu’il a connue, on décèle une très grande empathie pour ses héros et pour le pays et son histoire. Rigoureux sur les dates et les faits, s’appuyant sur de nombreuses citations, d’une écriture fluide et élégante, l’auteur conduit son lecteur à revisiter une période douloureuse où tant de violences auraient pu être évitées si l’on avait entendu les voix de ceux qui œuvraient pour la paix et la justice.
Le choix de Michel Kelle s’est porté d’abord sur deux Français de métropole : Germaine Tillon (1907-2008) ethnographe-ethnologue, et André Mandouze (1916-2006) universitaire, latiniste et… polémiste. Puis viennent trois « pieds-noirs » : Alfred Béranguer (1915-1996) prêtre, ambassadeur du FLN[2] en Amérique Latine ; Charles Koenig (1921-2009) instituteur, élu de Saïda et l’un des Européens de l’Exécutif Provisoire de 1962 préparant l’indépendance ; Pierre Claverie (1938-1996) religieux dominicain, évêque d’Oran, mort assassiné.
Ils ont tous en commun leurs origines et nationalité françaises et leur engagement aux côtés du peuple algérien. Germaine Tillon et André Mandouze avaient déjà payé de leur personne dans la résistance au nazisme : ils ont continué à résister en Algérie, l’une parce qu’elle ne supportait pas la « clochardisation » d’une population délaissée à laquelle ses études l’avaient attachée, l’autre par son engagement de chrétien de gauche épris de justice. C’est par fidélité à l’Evangile que le « curé » Béranguer luttera pour un peuple libéré de toute oppression. Le parcours de Charles Koenig, appelé à des responsabilités politiques lors de la transition, semble plus classique, mais c’est une belle figure d’instituteur syndicaliste engagé pour le développement d’une éducation à laquelle tous les enfants auraient dû avoir droit. Quant à Pierre Claverie, européen d’Alger élevé dans une « bulle coloniale », il appartient à une autre génération. Trop jeune pendant la guerre d’indépendance, il ne redécouvrira vraiment l’Algérie qu’à l’âge de trente ans quand il consacrera son ministère de prêtre et d’évêque à faire reconnaître et faire vivre « une humanité plurielle » en Algérie comme en France et en Europe.
A tous, la politique a été le moyen de leur engagement. Nombreuses sont les lettres envoyées par Germaine Tillon au général De Gaulle pour alerter, protester contre la torture et les exécutions. Nombreuses aussi ses navettes entre des ministres français et des responsables des combattants algériens (souvent clandestinement). André Mandouze trouvera naturellement une tribune dans Témoignage Chrétien (résistance !) et connaîtra révocations, surveillances et prison. Si Alfred Béranguer est le porte-parole du GPRA[3] en Amérique Latine, c’est qu’il est banni du territoire français, donc d’Algérie. L’engagement syndical de Charles Koenig l’amènera à la politique institutionnelle où il jouera un rôle de modérateur. Et Pierre Claverie, bien après l’indépendance, payera de sa vie ses prises de position par rapport à la violence exercée par les extrémistes du FIS[4]. « La religion, écrivait-il, ne peut servir de caution à aucun pouvoir. Elle est, au contraire, le ferment critique, intérieur à tous les systèmes possibles, qui les empêche de se refermer sur leur suffisance et de se faire idolâtrer. » Des paroles de conviction, sans doute trop politiques…
Tous ont été des « lanceurs d’alerte » (ou des prophètes ?). Germaine Tillon à De Gaulle, en 1959 : « Comment pourra-t-on empêcher les gens de ce pays si éprouvé, d’assouvir leur colère dans de meurtrières et cruelles sottises, quand une hiérarchie bien rodée, et à vos ordres, ne parvient pas à contenir notre propre armée ? » André Mandouze, dès 1980, sentant monter les tensions en Algérie : « Il faut condamner cette monstruosité du comportement qu’est l’intégrisme en soi… L’intégrisme a toujours été une sorte de maladie infantile du sentiment religieux. » A l’indépendance, Alfred Béranguer s’oppose au code de la nationalité qui stipule qu’un Algérien ne peut qu’être musulman, en contradiction avec la lutte d’émancipation qu’il a soutenue. Il voit pointer l’exclusion, et il garde son passeport français. « Français ou Algérien, non ; Français et Algérien, oui. » Lucide, Pierre Claverie écrivait en 1991 : « Le rêve d’une ‘république islamique’ ne va-t-il pas enfermer le pays dans une utopie passéiste à la veille du XXIe siècle ? Une certaine exaltation incantatoire de l’islam n’est-elle pas l’expression de l’impuissance de croyants déchirés entre authenticité et modernité ? » Il faut dater ces paroles, et bien d’autres au fil des pages, pour constater que, non seulement elles ont souvent été prémonitoires, mais qu’elles éclairent encore bien des situations géopolitiques et religieuses que nous connaissons aujourd’hui.
« Des modèles pour un renouveau des rapports franco-algériens » : cette sorte de sous-titre qui apparaît au bas de la couverture de l’ouvrage devrait avertir le lecteur qu’il n’est pas seulement question de nostalgie et de retour sur le passé. Certes, à travers ces cinq monographies successives, il s’agit bien d’histoire. On y rencontre d’ailleurs de grands noms de femmes et d’hommes des mondes politique, militaire, religieux, littéraire, économique… Tous, Algériens ou Français de métropole ou d’Algérie, connus ou inconnus, ils auraient pu trouver place dans ce livre : ils ont fait l’histoire. Mais les cinq personnages du choix de Michel Kelle, loin d’exclure les autres, sont proposés comme les modèles de ces « Passeurs des deux rives » de la Méditerranée dont le monde actuel a tant besoin.
Car ils ont mis leur intelligence, leur volonté et leur courage au service d’un dialogue entre les deux peuples « à la recherche du vrai et du juste, avec pour seule arme leur humanisme, leur intelligence et leur foi chrétienne ou laïque. » Chacune de leur vie est un message adressé à la nouvelle génération pour ouvrir un avenir de coopération et d’amitié entre peuples et religions dans l’espace méditerranéen. En ce sens, c’est bien un livre d’histoire pour aujourd’hui[5].
Claude Popin
[1] Auteur et coordonnateur d’ouvrages pédagogiques, Michel Kelle a écrit aussi de nombreux articles consacrés à des écrivains francophones d’Algérie, notamment Mouloud Feraoun et Emmanuel Roblès.
[2] Front de Libération Nationale
[3] Gouvernement Provisoire de la République Algérienne
[4] Front Islamique du Salut
[5] Ce livre a été publié avec le concours de l’Institut français d’Algérie qui intervient – en coopération avec des partenaires algériens – dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, des langues et de la francophonie et des échanges culturels et artistiques.