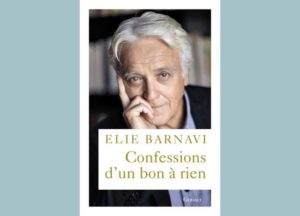Titre
Confessions d’un bon à rienAuteur
Elie BarnaviType
livreEditeur
Paris : Bernard Grasset, 16 mars 2022Nombre de pages
509 p.Prix
25€Date de publication
15 juillet 2022Confessions d’un bon à rien.
La vie d’Elie Barnavi, grande figure de la gauche israélienne et du mouvement La Paix Maintenant, à bien des égards, a les accents d’un roman.
Né à Bucarest en 1946 d’une mère moldave et d’un père originaire de Bessarabie, aux convictions communistes, qui a combattu le nazisme dans l’armée rouge, il est représentatif de centaines de milliers de juifs d’Europe centrale pour lesquels la proclamation de l’État d’Israël constitua l’espoir d’échapper à “l’antisémitisme qui couvait sous le mince vernis communiste”.
Un séjour d’un an, passé dans un kibboutz, l’initie à ce pays où il débarque en 1961 et dont il ignore tout. Peu après, parachutiste pendant la guerre des Six jours, il vit les heures intenses de la prise de Jérusalem, puis s’engage dans une brillante carrière d’historien, soutient une thèse en Sorbonne où il côtoie l’intelligentsia française, entre en politique peu avant que la gauche israélienne cède le pouvoir, devient ambassadeur à Paris, participe à la fondation du Musée de l’Europe, siège avec quelques dizaines de happy few au Club de Monaco. Vie étonnante d’un intellectuel éminent et chaleureux, épris de culture française dont il pratique la langue en virtuose. On pense parfois à Fabrice del Dongo, au Casanova des Mémoires et aussi bien sûr au Solal d’Albert Cohen.
Mais Elie Barnavi est bien plus qu’un personnage de roman. C’est un acteur authentiquement engagé dans son époque – “nos credo politiques sont d’abord affaire de sentiment” écrit-il -, qui éprouve constamment le besoin de mettre à distance les évènements dans lesquels il s’implique pour tenter de les étudier, avec “la rigueur de l’historien” dont il prétend ne pas se départir, d’où ses allers-retours incessants entre l’engagement et l’étude, la politique et l’université, la diplomatie et l’écriture.
Ses confessions sont ainsi l’occasion de revenir sur quelques-unes de ses convictions. A propos du Proche-Orient, s’il est persuadé de l’absolue nécessité pour les juifs de disposer d’une nation-refuge, E. Barnavi croit tout autant dans l’exigence de deux États cohabitant en paix. Il ne dissimule pourtant pas son pessimisme en voyant triompher un sionisme messianique qui, se conjuguant à l’activisme islamiste, a rendu insoluble un conflit désormais enfermé dans sa rhétorique religieuse, ce qu’il avait pressenti très tôt, en étudiant l’utilisation politique de la religion dans la France des Ligues.
Ses analyses de la société israélienne qui se voulait le creuset du “juif nouveau” – mais n’est pas parvenue à rassembler les cultures, venues des quatre coins du monde, qu’elle a attirées -, comme la place singulière qu’occupent l’armée et la guerre dans cette nation en armes sont éclairantes.
Son engagement en faveur de l’idée européenne qui l’absorbera, tant en historien qu’en pédagogue, au sein du Musée de l’Europe, est tout aussi réfléchi. Rappelant, après Henry Laurens, que le sionisme est un nationalisme européen qui n’aurait pas renoncé à l’universalisme, il déplore que son pays ait oublié la distinction du temporel et du spirituel, trait fondamental de la civilisation européenne, ailleurs inconnu.
D’une plume subtile, à l’occasion sarcastique, il dresse enfin une galerie de portraits savoureux. De Golda Meir “la redoutable alliance d’un caractère d’acier et d’un esprit borné” à Mitterrand “jamais je n’avais vu le pouvoir s’exercer de manière aussi brute” en passant par Shimon Péres – dont il note “l’imbécillité” -, Michel Rocard, Jacques Le Goff, François Furet, Pierre Vidal-Naquet, Ariel Sharon ou Hubert Védrine, sa revue du gotha est un vrai régal.
Voici donc un ouvrage qui mêlant avec justesse histoire personnelle et contemporaine, livre la pensée d’un homme qui, s’il eut soif d’engagements, s’efforça toujours de rester libre.
Bernard Ughetto
Adhérent CDM