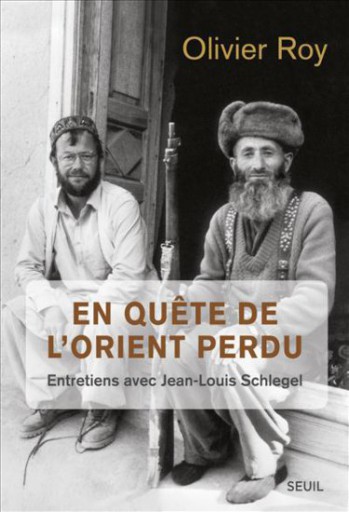Titre
En quête de l'Orient perduSous titre
Entretiens avec Jean-Louis SchlegelAuteur
Olivier RoyType
livreEditeur
Seuil, 02/10/2014Nombre de pages
324 p.Prix
21 €Date de publication
26 juin 2015En quête de l’Orient perdu
Stimulé par les questions pertinentes de son interlocuteur, Olivier Roy, simultanément, se raconte à force d’anecdotes topiques et nous ouvre sa boîte à outils.
Le récit de son existence se fonde sur le constat, rétrospectif, d’avoir changé de vie tous les dix ans. L’auteur s’interroge au passage sur ce goût pour la rupture et les rebondissements à neuf, sans nous livrer une clé d’interprétation, pas plus que son psy.
La décennie des années 1970 est celle, heureuse, du prof de philo à Dreux et de la découverte de l’Afghanistan après avoir tâté du persan dès son passage au lycée Louis le Grand. En khâgne dans cet établissement, il a vu de près la Gauche prolétarienne et ce compagnonnage d’un instant l’inspirera plus tard pour comprendre que les islamistes extrémistes s’expliquent mieux par la lecture de Dostoïevski que par celle du Coran. Voyageur ethnographe, il part à Kaboul en lecteur enthousiaste de Kipling et de Nicolas Bouvier (L’usage du monde.- Droz, 1963.-Réed. 1999). L’invasion soviétique de 1979 convertit le jeune philosophe – au mode de vie gauchiste – à un militantisme averti des ruses de l’histoire. Roy a des pages stimulantes sur la génération afghane des années 1980. Ses séjours dans le pays pachtoun sont un mixte de raid humanitaire périlleux et de carnet de route de scientifique méticuleux. Il apprend sur place le « body langage » et privilégiera dès lors le travail de terrain sur la théorie en chambre. Il y élabore le matériau de L’échec de l’islam politique (Seuil, 1992.-Réed. 2015), qui le consacre comme l’un des tout meilleurs analystes du phénomène islamiste.
Les années 1990 le font pivoter vers l’Asie centrale, où il observe la naissance des États nations sur les décombres de l’URSS. Elles le consacrent comme expert consulté par aussi bien des think-tanks néoconservateurs américains que par la diplomatie russe. Les années 2000 sont celles du retour à Dreux, site privilégié pour observer la métamorphose des immigrés maghrébins en musulmans communautarisés, à se fier à l’énoncé, trompeur, de la sémantique en l’air. C’est depuis Dreux, puis de l’Institut universitaire européen de Florence qu’il interprète le phénomène de globalisation d’un islam déterritorialisé et l’avènement de la « Sainte ignorance[1] » partagée en commun par les salafistes, les évangéliques du Tea Party, les néo-indianistes, bref tous les fondamentalistes, surtout quand ils sont des born again…
Cet ouvrage est un captivant essai d’autobiographie intellectuelle, en particulier lorsque Roy aborde, dans son avant-dernier chapitre, ce qu’il doit à son éducation, plus encore à sa formation (sa bildung) protestante à la Rochelle. Il foisonne de formules choc (« Le Coran dit ce que les musulmans disent qu’il dit »), d’affirmations outrancières (l’équivalence entre tous les fondamentalismes issus de la même matrice idéologique) et de paradoxes non élucidés. Roy affirme ne pas se prendre au sérieux en invoquant Montaigne, mais il nous rapporte qu’Hubert Védrine lui téléphone dès le 12 septembre 2001 pour commenter l’événement. Il prend la pose du chercheur solitaire, mais son approche du phénomène religieux s’abreuve à Marcel Gauchet (les effets de l’expulsion du religieux de la scène publique) et à Danièle Hervieu Léger (la distinction entre religion et religiosité) qu’il ne cite même pas.
En somme ce brillant essai d’ego-histoire donne à voir, sentir, penser le fait religieux et son inscription dans le présent, mais est à lire avec un esprit critique, je dirai même caustique.
Daniel Rivet
[1] La Sainte Ignorance. Le temps de la religion sans culture/Olivier Roy.- Seuil, 2008.-Réed. 2012