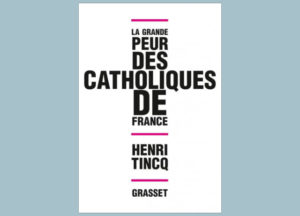Titre
La grande peur des catholiques de FranceAuteur
Henri TincqType
livreEditeur
Paris, Grasset, 28 mars 2018Nombre de pages
204Prix
18 €Date de publication
30 avril 2018La grande peur des catholiques de France
Un humoriste impertinent posait, il y a quelques jours, sur France Inter[1], la question suivante : « Les journalistes doivent-ils maîtriser les sujets qu’ils traitent ? » C’est précisément la question que je me suis posée, me concernant – avant de me risquer à faire la recension du livre d’Henri Tincq – mais, paradoxalement, elle m’a décidée à me lancer car le journaliste, c’est lui !
On ne sera donc pas surpris qu’un spécialiste des questions religieuses à La Croix, puis chef de la rubrique religieuse au journal Le Monde (1985-2008), aujourd’hui chroniqueur à Slate [2] et au Monde des religions, et auteur de nombreux livres et articles sur le catholicisme et les catholiques [3] traite avec maîtrise et expertise La grande peur des catholiques de France, « cet essai qui n’a d’autre ambition que de prolonger le débat sur l’identité catholique en 2017 » (p.199). En partant du constat suivant : « La longue séquence électorale de 2016-2017 a consacré une visibilité nouvelle et un net virage à droite du catholicisme français », Henri Tincq se propose « d’en comprendre mieux les raisons et les filiations » (p.37).
Pour ce faire, il part du réel et procède à une radiographie du catholicisme français contemporain, en faisant un inventaire impressionnant des courants, réseaux, sites et blogs, radios, presse, communautés, associations et personnalités…etc. qui constituent ce qu’il appelle « la galaxie ‘catho’ identitaire » (ch.2). Il adopte une démarche de sociologue en s’appuyant sur des enquêtes nombreuses d’instituts de sondage ou sur des études récentes de politologues[4]. Mais son regard d’historien est peut-être encore plus précieux car il lui permet de montrer comment le « néo-conservatisme » et la « droitisation » repérables actuellement dans l’Église catholique ont des racines profondes et anciennes dans son histoire marquée par le triple héritage de la Contre-Réforme, de la Contre-Révolution, du Contre-Modernisme, bref, un passé qui a engendré le catholicisme « intransigeant » du 19e et du début du 20e siècle[5].
Aujourd’hui, cette « nouvelle ‘intransigeance’ catholique » (ch. 3) est partagée à la fois par des catholiques traditionalistes proches de la droite dure voire de l’extrême-droite[6] et des charismatiques, d’où l’appellation « tradismatiques[7] » : ils prônent le retour à la tradition catholique comme arme contre ce qui alimente leur « grande peur » et leur « insécurité culturelle » (p. 12, 42, 196) à savoir : la dissolution des valeurs chrétiennes dans la société ; l’éclatement de la famille traditionnelle ; le relativisme religieux ; la progression d’un islam radical devenu, depuis les attentats, de plus en plus anxiogène (ch. 5) ; l’immigration croissante ; une laïcité toujours plus militante (ch. 6)…etc. (67-68). Mais c’est surtout le projet de loi instituant le mariage pour tous qui a provoqué une « panique morale[8] » devant ce qui est ressenti comme « une vraie rupture de civilisation » (ch. 4)
Son analyse approfondie de la peur des catholiques montre qu’Henri Tincq la prend au sérieux, mais pour lui le « repli identitaire défensif » ne peut être une attitude en cohérence avec l’Évangile ni une réponse aux graves problèmes de notre société : par un nouveau recours à l’histoire, il rappelle donc le rôle du « catholicisme social », des mouvements d’Action catholique, de tous ces militants catholiques qui dans les partis, les syndicats vont rejoindre les luttes pour plus de justice sociale ; il évoque la foi chrétienne des « Pères fondateurs de l’Europe[9] », il cite les théologiens réformateurs qui seront réhabilités par le Concile Vatican II qu’ils auront, en quelque sorte, préparé ; il nomme les évêques conciliaires qui ont su traduire dans leurs textes les grandes avancées de Vatican II (ch. 7- 8). Il relit « toute cette page des années 1950-1970, l’une des plus exaltantes […] un âge d’or pour les mouvements d’Église » (p. 165) avec d’autant plus de passion et de ferveur qu’il l’estime oubliée ou disqualifiée ; il retrouve les accents des prophètes de la Bible pour protester contre « le procès terriblement injuste » fait aux catholiques qui ont mis en œuvre l’élan social, missionnaire, œcuménique donné par le concile Vatican II, et il montre en quoi « ce procès est une injure à l’Histoire et à la vérité. » (p.159, 175).
Quelques remarques, en terminant, pour souligner encore tout l’intérêt du livre d’Henri Tincq…
La capacité d’indignation d’Henri Tincq nous réveille ; elle est servie par un style vif et une plume alerte mais peut-être encore plus par le ton de sa voix quand il s’exprime dans les médias[10] ; elle nous renvoie à Emmanuel Mounier et à son livre L’affrontement chrétien[11]. Car si le livre d’Henri Tincq est celui d’un journaliste très compétent pour parler de l’Église catholique il est aussi, et peut-être surtout, celui d’un chrétien engagé, un catholique conciliaire, toujours animé par le souffle du Concile Vatican II et très attaché à cette Église dont il parle de l’intérieur, qu’il considère comme sa famille, à qui il rend un vibrant témoignage en évoquant les grandes figures qui l’ont marqué (p.195-198). Pourtant, dès la première page, il avoue : « Je ne reconnais plus mon Église »… Mais il faut le lire jusqu’au bout pour comprendre qu’il la reconnaît dans « le modèle que le pape François propose, celui d’une Église qui accueille avant de juger, qui soigne les blessures avant d’énoncer des commandements, qui invite ses fidèles à « sortir dans la nuit, à croiser leur route, à aller aux périphéries essentielles » (p.194-195).
Le moment où paraît La grande peur des catholiques de France, le 28 mars 2018, ne peut pas mieux tomber : entre l’Exhortation apostolique du pape François, La joie et l’allégresse : Gaudete et exultate, signée le 19 mars et la rencontre entre le Président de la République, Emmanuel Macron, et les catholiques de France, au Collège des Bernardins, le 9 avril. Le pape François exhorte – c’est-à-dire : encourage par ses paroles – les catholiques en leur rappelant que Dieu les appelle à la sainteté[12] (n°10) et les « pousse à partir […] vers les périphéries et les frontières […] là où l’humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la superficialité et du conformisme continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie ». Et le pape François, ajoute : « Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les périphéries. Lui-même s’est fait périphérie » cf. Ph 2, 6-8 ; Jn 1, 14 (n°135).
De son côté, le président Macron déclare aux évêques de France : « J’ai entendu les inquiétudes montant du monde catholique » que ce soit au sujet des migrants ou de la bioéthique, et il poursuit : « Nous écoutons avec intérêt et respect cette voix de l’Église… » – confirmant ainsi le constat d’Henri Tincq : « l’Église s’est frayé une place globalement respectée dans la société française » (p.198) – tout en reconnaissant : « … mais nous savons vous et moi qu’elle ne peut être injonctive […] Elle ne peut dès lors être que questionnante ».
La laïcité n’empêche pas l’Église catholique de poser les questions qui lui tiennent à cœur en participant aux débats de société. Actuellement, par exemple, « le grand débat autour de la révision des lois de bioéthique permet une réflexion commune sur « Quel monde voulons-nous pour demain ? » reconnaît Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de France ; il s’en réjouit et a remercié le Président de la République, lors de leur rencontre du 9 avril, d’avoir favorisé ce débat[13].
Que l’Église entre dans le débat sans être « injonctive », n’est-ce pas ce que souhaitait déjà le théologien jésuite, Paul Valadier[14] dans un livre paru 30 ans avant celui d’Henri Tincq et toujours d’actualité : L’Église en procès : catholicisme et société moderne[15] : « l’acceptation franche du débat suppose quelques conditions de la part de l’Église. De maîtresse et détentrice de la vérité morale, l’Église doit accepter de devenir interlocutrice et partenaire du dialogue […] Entrer dans le débat veut dire qu’on accepte de discuter ; […] d’être une voix parmi d’autres. […] Dans une société du débat institué, seule une Église capable d’instituer le débat en son sein sera crédible » (p. 141-144, 213-214).
C’est aussi la conviction d’Henri Tincq : « Les religions ne pourront rejouer leur rôle qu’en évacuant leurs dérives et en favorisant toutes les formes de dialogue avec la société laïque » (p.155) et, j’ajouterai : « et entre elles aussi, pour former ensemble et avec d’autres un réseau d’acteurs de paix » !
Nicole Girardot
[1] Il s’agit d’Alex Vizorek, qui, juste avant la revue de presse de 7h45, le 17/04/2018, posait cette question à laquelle il allait répondre ensuite dans son billet.
[2] Cf. Les nombreux articles d’Henri Tincq sur Slate
[3] Cf. Dieu en France : mort et résurrection du catholicisme.- Calmann-Lévy, 2003 ; Les catholiques.- Grasset, 2008 ; Catholicisme, le retour des intégristes.- CNRS Éditions, 2009.
[4] Cf. p. 39 : Enquête IPSOS de Yann Raison du Cleuziou et Philippe Cibois, publiée dans La Croix du 11 janvier 2017 : Qui sont vraiment les catholiques de France ?
[5] Cf. Note 2 p. 64 : Permanence d’un catholicisme intransigeant ? / Charles Mercier, revue Études d’octobre 2013. Et note p. 66 signalant la tribune, dans La Croix du 22/04/2013, intitulée : Le catholicisme intransigeant, une tentation permanente, de Mgr Claude Dagens, « Le premier à avoir sonné l’alarme, en 2013, sur le danger d’un retour à l’intransigeance catholique » (p.65).
[6] « Comment ne pas s’indigner devant la caution accordée par des électeurs catholiques, même en petit nombre, » au programme de Marine Le Pen alors que « Tout sépare en effet le message de l’Église des thèses du Front national » (p.31-32)
[7] Note p. 87 : article, paru le 13/01/2017, de Gaël Brustier, chercheur à l’Observatoire des radicalités politiques. C’est à lui principalement qu’on doit le nom de « tradismatiques », cf. :
Les tradismatiques à l’assaut du pouvoir . Du même auteur, H.T. cite un livre qu’il estime convaincant, cf. note p. 93 : Le Mai 68 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous ?–Le Cerf, 2014
[8] Expression employée par les 2 politologues Céline Béraud et Philippe Portier dont le livre est cité en note p. 99 : Métamorphoses catholiques : Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage pour tous.- EMSH, 2015
[9] Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, etc.
[10] On pourra l’écouter dans la Matinale de France-Culture, le lendemain de Pâques, lundi 02/04/2018 : 1ère partie Faut-il asseoir les catholiques à la droite de l’échiquier politique ? (17 mn) et 2ème partie : (23 mn).
et aussi dans Le temps de le dire, sur RCF, le mercredi 25/04/2018, où il était invité avec Pascale Tournier, sur : Le courant néo-conservateur chez les catholiques (55mn).
[11] L’affrontement chrétien.- Parole et Silence, 2006 dans lequel Emmanuel Mounier « lance un appel prophétique aux croyants pour qu’ils prennent enfin au sérieux l’abrupt évangélique. » (Guy Coq, 4ème de couv.)
[12] « La sainteté pour tous », titrait La Croix du 10/04/2018, en gros caractères et non sans un clin d’œil d’humour adressé à « La Manif pour tous » !
[13] Discours du président Macron et de Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de France et article d’Henri Tincq sur Slate, le 10 04 2018
[14] Qu’Henri Tincq n’oublie pas de nommer, p. 171, avec d’autres théologiens.
[15] Édité, en 1987, chez Calmann-Lévy.-(Liberté de l’esprit) et réédité en poche dès 1989 chez Flammarion.-(Champs). Les pages indiquées, ici, sont celle de l’édition de 1987.