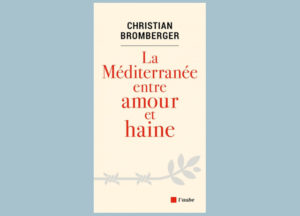Titre
La Méditerranée entre amour et haineAuteur
Christian BrombergerType
livreEditeur
La Tour d’Aigues, L’Aube, 2018Collection
MéditerranéesNombre de pages
126Prix
14 €Date de publication
7 août 2018La Méditerranée entre amour et haine
On n’en finit jamais d’explorer le monde méditerranéen. Et pourtant, ce court ouvrage, de lecture aisée, apporte sa petite touche particulière par les aspects évoqués ou développés, et par la réflexion proposée dans le contexte actuel. Christian Bromberger, ancien professeur d’ethnologie à l’université d’Aix-Marseille, est un connaisseur du terrain. Il invite à un bref survol de l’espace et du temps pour mieux comprendre un monde aux contrastes accentués.
Sans recourir explicitement à la géographie et à l’histoire, l’auteur évoque quelques caractères communs : les paysages, le climat, les ressources, les odeurs, les couleurs… autant de réalités qui inciteraient à l’unité et à la cohérence. C’est donc naturellement que la Méditerranée sera la mer des rencontres et des échanges, aussi bien économiques que culturels. L’ethnologue peut alors se livrer à détailler les invariants qui traversent toutes les sociétés méditerranéennes : la parenté, le mariage, les questions d’héritage, les structures sociales, y voyant « un fond commun de connivences, permettant aux hommes de se connaître et de se reconnaître ». De là, l’étude d’un certain nombre de comportements sociaux : le sens de l’hospitalité ostentatoire, de l’honneur, de la force de la virilité (et sa contrepartie : la misogynie), des structures clientélaires (auxquelles l’auteur rattache, dans le domaine sacré, le recours aux saints du christianisme et, en partie, de l’islam), l’appétence pour les compétitions (depuis les Jeux olympiques grecs, les Bleus et les Verts de Byzance, les courses de chevaux des ligues italiennes jusqu’aux clubs de foot d’aujourd’hui), la violence des relations, les lamentations funèbres et doloristes et le culte des « martyrs », qu’ils soient religieux ou politiques.
Et malgré ces constantes sociales, la Méditerranée, c’est aussi des exclusions, des croisades, des invasions, des colonisations, de la difficulté du métissage. Le XXe siècle y apporte les nationalismes intransigeants et les raidissements ethnoreligieux. On peut encore rêver de l’âge d’or de l’Andalousie médiévale ou de Sarajevo naguère, mais la cohabitation a toujours été plus contiguïté (les uns à côté des autres), qu’unité et dialogue. Comme si les peuples méditerranéens étaient trop proches les uns des autres, par leurs pratiques et leurs comportements, pour se distinguer et affirmer leur identité.
Cette recherche de « différences complémentaires » fait l’objet d’un intéressant chapitre où sont analysées certaines pratiques religieuses du même monde abrahamique. Car la Méditerranée a donné naissance aux trois monothéismes qui présentent des usages identiques, la plupart venus des sociétés primitives d’avant les « révélations » et qui n’ont donc rien à voir avec la croyance en un seul Dieu, que pourtant chacun revendique pour sien… Ainsi en est-il du jeûne, de l’usage du voile féminin, du système pileux pour les hommes, du sang menstruel ou animal, des interdits alimentaires (viande hallal et refus du porc ou du vin). L’auteur souligne d’ailleurs assez malicieusement que le judaïsme et l’islam se retrouvent très proches dans leurs préceptes et leurs interdits, alors que le christianisme fait figure de « révolutionnaire » puisqu’aucun aliment n’y est impur et que le vin participe au symbole du sang du Christ… Comment affirmer son identité propre quand on est si proche de l’autre ?
Ce ne sont pas les monothéismes qui ensanglantent aujourd’hui les rives de la Méditerranée, mais la crispation sur des différences, petites ou grandes, malhonnêtement travesties ou fantasmées, mal vécues en tout cas dans une mondialisation qui apparaît menaçante pour les identités. Le repli sur soi contribue à durcir les oppositions. Dans cette Méditerranée, « entre amour et haine », l’auteur estime que « les valeurs partagées ne doivent pas masquer la vigueur vécue des antagonismes ». Mais il préconise « une voie pour les surmonter : prendre conscience de leur relativité et en récuser le caractère absolu. Sur ce chemin, la route est encore longue… »
Claude Popin