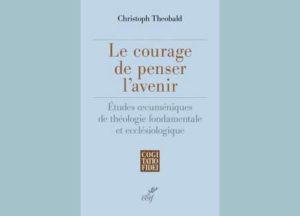Titre
Le courage de penser l’avenirSous titre
Etudes œcuméniques de théologie fondamentale et ecclésiologiqueAuteur
Christoph TheobaldType
livreEditeur
Paris : Cerf, 2021Collection
Cogitatio Fidei ; 311Nombre de pages
627p.Prix
29 €Date de publication
16 avril 2022Le courage de penser l’avenir : études œcuméniques de théologie fondamentale et ecclésiologique.
Cette somme impressionnante de théologie fondamentale et d’ecclésiologie est le résultat de plus de cinq ans de travail qui avait permis la publication, dans des revues spécialisées peu accessibles au grand public, d’une vingtaine de textes écrits entre 2015 et 2020.
Le rassemblement bienvenu de toutes ces études obéit à une architecture structurée en quatre parties.
La première partie concerne trois chapitres sur le concile
Vatican II, une des spécialités de l’auteur. Il s’agit d’abord d’examiner la “pastoralité” de l’enseignement du concile, c’est-à-dire l’intention pastorale de cette réunion d’évêques par opposition à des conciles plus dogmatiques. Le développement de vingt pages sur ce thème en montre la complexité, notamment la hiérarchie des vérités qui s’impose contre le rêve d’une conception monolithique de la doctrine. Les chapitres suivants traitent en profondeur des constitutions Dei verbum1 et Gaudium et spes2 du concile. L’auteur a inclus dans cette première partie sa réflexion sur les mutations de l’humain et les défis de l’anthropocène. Il termine par un chapitre sur la vie consacrée dans l’Église.
La deuxième partie de ce volume offre des études qui tournent autour de la théologie du pape François, autre sujet de prédilection de l’auteur. Partant d’un travail sur l’exhortation apostolique Evangelii gaudium3, il introduit la notion de style évangélisateur qu’il va ensuite développer dans le concept de “christianisme comme style”, par exemple, le style de vie de l’Évangile. Les chapitres suivants s’attachent à l’enseignement social de l’Église selon François et à la mystique de la fraternité qu’il développe.
La troisième partie, la plus importante puisqu’elle court sur 200 pages, s’attache à revisiter les fondamentaux de la théologie. Qu’est-ce que la révélation ? Qu’entend-on par le sensus fidei, le sens de la foi des fidèles et ses conséquences ? Que peut-on dire sur la théologie de l’institution conciliaire ? Comment aborder la mutation du rôle de l’autorité, sinon à travers le dialogue ? Quelle théologie mettre en pratique pour une Église en diaspora ? Toutes ces questions font l’objet d’un travail de fond, toujours en référence à la tradition et aux textes récents.
La quatrième partie traite de l’œcuménisme. Le théologien observe d’abord le renouveau œcuménique au XXe siècle, grâce au concile Vatican II bien entendu, mais aussi aux multiples dialogues qui ont suivi. Le concile a donné une image d’une Église en délibération, et cela en présence des frères séparés, en espérant que l’eucharistie devienne un geste de communion qui manifeste l’unité dans la foi. Le pape François a su relancer la dynamique œcuménique par de multiples rencontres. L’auteur estime qu’il est temps de s’interroger sur le courage des chrétiens d’envisager un avenir commun : il faut un vrai courage spirituel en effet pour envisager les conditions d’une possible unification des Églises. En terminant ce chapitre, Christoph Theobald propose d’entrer avec détermination dans une nouvelle phase œcuménique. La fragilisation de l’ensemble des Églises historiques, comme la crise des abus sexuels dans le catholicisme, les ruptures répétées au sein de la communion orthodoxe, ou l’émergence de nouvelles Églises évangéliques au sein du protestantisme, invite à l’approfondissement de la démarche de chacune de ces Églises.
En conclusion d’un parcours foisonnant d’analyses et d’interrogations, le théologien nous tourne vers l’avenir, en soulignant quelques thématiques fondamentales : d’abord les urgences sociales et écologiques, ensuite les urgences ecclésiologiques d’une Église en mutation, notamment sur les manières de mener à bien la mission, enfin les urgences christologiques et sacramentaires, qui remettent en question notre foi peut-être trop élémentaire, et qui nous mènent à porter un regard contemplatif sur les profondeurs de Dieu alors que nous sommes invités plus que jamais à relier vie contemplative et vie active, comme le montre le “genre de vie” du Christ lui-même.
Certes, il faut de la constance et beaucoup d’attention pour suivre Christoph Theobald au fil de ces pages, mais l’enrichissement du lecteur est à la mesure de l’investissement de l’auteur.
Pierre de Charentenay
Institut catholique de la Méditerranée, Marseille (ICM)
Notes de la rédaction
3 Exhortation apostolique : Evangelii Gaudium / Pape François