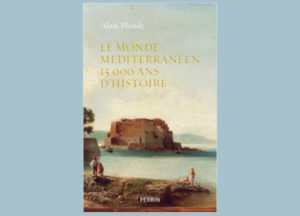Titre
Le monde méditerranéenSous titre
15 000 ans d’histoireAuteur
Alain BlondyType
livreEditeur
Paris, Perrin, avril 2018Nombre de pages
447Prix
23,50 €Date de publication
7 août 2018Le monde méditerranéen
Deux mots voisins pourraient caractériser ce gros ouvrage : « frise » et « fresque ».
Frise d’une chronologie qui a l’ambition de couvrir un « temps long », selon l’expression de l’auteur.
Fresque à la mode impressionniste, car tout y est rassemblé, parfois sous des éclairages différents, révélant des correspondances, « le sac et le ressac de l’histoire » pour utiliser une autre métaphore qu’on lira en introduction. Alain Blondy, longtemps professeur à la Sorbonne, à Tunis, Chypre, Malte…, considéré comme l’un des meilleurs spécialistes actuels de la Méditerranée, réussit une magistrale synthèse de connaissances, moins pour « apprendre » que pour faire « comprendre » et analyser une histoire dont nous sommes encore largement tributaires.
Le « temps long » ne permet pas à l’auteur de s’encombrer du détail des faits. Une simple chronologie, en début de chaque chapitre, rappelle quelques événements significatifs de la période étudiée. Il ne s’appesantit pas davantage sur des considérations géographiques, anthropologiques, ethnologiques ou climatiques. Tout l’intérêt est de comprendre comment des migrants ont progressivement occupé des territoires et maîtrisé la navigation pour améliorer leurs échanges commerciaux. Et l’on assiste à l’élaboration d’une pensée philosophique avec la Grèce, d’une organisation politique avec l’Egypte et juridique avec Rome, à la naissance d’un monothéisme, source des trois grandes religions qui s’en réclament. La Méditerranée trouve son unité avec la mare nostrum des Romains.
L’irruption d’autres migrations, germaniques en Occident, arabes et mongoles en Orient, va fracturer l’Empire Romain. Perte d’une unité politique artificielle au profit de l’émergence des différences ethniques, religieuses et culturelles. Et c’est ici qu’il faut apprécier la pédagogie de l’auteur. S’appuyant sur des sources diversifiées, orientales ou occidentales, il expose, parfois en quelques phrases percutantes, les situations complexes qui vont peser sur l’histoire des peuples et de leurs relations. Tous les domaines sont appréhendés.
Celui des mentalités, d’une part. Par exemple, comment la division de l’Empire entre Rome et Byzance n’a fait qu’entériner le constat de deux manières de vivre et de voir, l’orientale et l’occidentale, sensibles dès la querelle des images1 au IXe siècle. La rupture sera consommée en 1054.
D’autre part, les disputes théologiques, dites « byzantines », autour de la divinité de Jésus permettent de comprendre pourquoi bon nombre de chrétiens orientaux, restés ariens, trouveront dans l’islam conquérant un monothéisme qui leur sera plus accessible que les complications trinitaires. Et dans le domaine de la géopolitique, on constatera les interpénétrations : les fastes et l’organisation sociétale de Byzance ont été recopiés par les califats musulmans successifs. D’ailleurs l’auteur met en évidence la similitude de l’itinéraire de ces deux monothéismes qui, à leurs débuts, se divisent en de multiples interprétations pour des raisons qui leur sont propres. Sunnisme et chiisme se différencient dès l’origine.
Les germes du déclin sont sensibles dès le Xe siècle. L’Empire byzantin se rétrécit comme peau de chagrin autour de Constantinople qui finira par tomber en 1453. Déjà au IXe siècle, l’Islam s’était figé : un calife abbasside (Bagdad) avait imposé la croyance en la non-création du Coran. « Ce faisant, il porta un préjudice fatal à l’islam qui, jusqu’alors avait été le continuateur du savoir et de la culture antiques et qui désormais s’enferra dans un fixisme idéologique et religieux qui lui interdit de participer au renouveau du Xe siècle et à la modernité qui en découla. » (p. 127)
En Occident, on arrive difficilement à des compromis sur les questions de pouvoir politique ou religieux. Vint alors le « triomphe des marchands » : Amalfi (Naples), Gênes, Venise et les îles Malte, Sicile, Chypre. La Méditerranée retrouvait sa fonctionnalité des échanges commerciaux, mais cette fois avec un déséquilibre nord-sud patent.
Alors que le nord européen s’enrichissait du commerce et se développait en perfectionnant les techniques de navigation, des banques, de l’agriculture et de l’industrie de production, le sud stagnait dans une économie de subsistance. L’irruption de turcs islamisés menés par d’anciens esclaves, les Mameluks, aggrava la situation : ils contrôlèrent bientôt l’Asie Mineure, l’Egypte et la côte africaine. Plus habitués à combattre qu’à produire, ils initieront la piraterie (se servir chez les autres…) qui sévira de façon endémique en Méditerranée pendant des siècles, notamment à partir des trois « Régences » : Tripoli, Tunis et Alger, théoriquement sous contrôle turc, mais indépendantes pour leurs ressources.
Le déséquilibre n’est pas qu’économique. Fort de sa richesse, donc de son pouvoir, l’Occident va bientôt vouloir se réapproprier l’espace méditerranéen. Le mythe de la mare nostrum de la Rome païenne subsiste sous la Rome chrétienne. Les croisades, le sac de Constantinople, la reconquête espagnole, le contrôle des Balkans, la « protection » des populations chrétiennes et bientôt les « protectorats » et la colonisation : autant d’interventions à visée hégémonique qui vont se concrétiser au long de plusieurs siècles.
Même en déclin au profit de l’Atlantique, après la découverte des Amériques, la Méditerranée attirera d’autres nations non-riveraines : la Russie et surtout l’Angleterre qui s’appropriera le contrôle de territoires sur sa route des Indes : Gibraltar, Malte, Chypre. Tout cela ne se fait pas sans conflits épisodiques. Mais qui se souvient, entre autres événements significatifs, qu’en 1541, Charles-Quint assiège Alger sans pouvoir prendre la ville ? Que Louis XIV mène, dans les années 1670, une lutte maritime acharnée contre les « Barbaresques » ? Qu’en 1816, les Anglais bombardent violemment Alger lors d’une expédition punitive ? Et que les Français, en 1830, débarquent au même endroit en s’y établissant ? Il s’agissait toujours des mêmes prétextes : lutter contre la piraterie prédatrice, contre la prise d’otages réduits en esclavage, bref : garder la maîtrise des voies commerciales de la Méditerranée.
La montée en puissance des Etats-nations, le triomphe de la révolution industrielle en Occident et le choc des grands Empires, dont l’Empire ottoman, vont marquer l’époque moderne. Auxquels il faut ajouter l’avènement du communisme, porteur de l’espoir de libération des peuples opprimés. Mais les vainqueurs de 1918 ont ouvert la voie à une série de déceptions que l’auteur analyse dans ses derniers chapitres. Le renouveau arabe, la Nahda,2 libéré de l’emprise turque, ne peut surmonter ses antagonismes religieux internes et sombre bientôt dans des nationalismes musclés, tous plus ou moins sous « influence » occidentale, celle-ci symbolisée et cristallisée par son soutien à un nouveau venu : Israël.
Les libérations successives de cette dépendance de l’Occident, avec la fin de la colonisation, aboutiront la plupart du temps, à des régimes militaires (Syrie, Egypte, Lybie, Algérie) ou à des états policiers (Tunisie), dont les « printemps arabes » auront bien du mal à se défaire. Le communisme, de son côté, a viré à la dictature oppressive. Alors, face à un Occident qui, malgré la seconde guerre mondiale, étale avec insolence sa réussite matérielle, la tentation est grande, pour les peuples d’Orient, de se tourner vers le seul point de repère qui semble leur rester de leur identité : la religion, un islam fantasmé dans sa soi-disant pureté originelle du VIIe siècle, ou « dans le rétablissement d’un imaginaire califat, bricolage idéologique où se mêlent des éléments d’origine musulmane ou européenne réinventés ». Et l’auteur peut ajouter : « L’intégrisme religieux put dès lors se substituer à la vacance des idéologies politiques et à la vacuité d’esprits faibles laissés à la dérive par le matérialisme hédoniste des pays occidentaux ». (p. 362).
Pour Alain Blondy, la Méditerranée est incontestablement aujourd’hui une zone fracturée. Y en a-t-il une illustration plus terrible que le contraste entre ces paquebots bourrés de touristes occidentaux, vacanciers amateurs de soleil, qui croisent les embarcations surchargées de migrants fuyant le manque de liberté politique, l’intolérance religieuse et la misère ? Les mots sont durs : « Les scarifications imposées au monde méditerranéen par l’histoire se sont muées en ornières… Orphelin d’une unité qui n’a jamais sans doute véritablement existé, le monde méditerranéen n’est plus que l’horizon commun de blocs antagonistes. » (p. 369-370). Le lecteur devra en prendre acte, tant il est vrai que, plus qu’une étendue d’eau, la Méditerranée est surtout l’idée qu’on se fait d’elle, la vision qu’on en a et qui conditionne toute politique à mettre en œuvre.
Ce survol de 15000 ans d’histoire est passionnant et se lit avec un plaisir renouvelé à chaque phrase, puisque chacune apporte une information, un point de vue, une perspective, un rapprochement. Sur une structure de « frise » chronologique, l’auteur réussit une véritable « fresque » multicolore où la touche et la sensibilité du peintre ne sont pas absentes du tableau, ce tableau contrasté d’une part de l’humanité qui est la nôtre, sur les rives de la Méditerranée.
Claude Popin
1 Lire Bref aperçu de la querelle des images / Boris Bobrinskoy, in revue Contacts, n° spécial sur l’Icône, n°32, 1960.
2 Voir article d’Anne-Laure Dupont sur la Nahda in Monde diplomatique, août-sept. 2009.