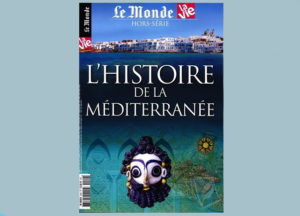Titre
L’histoire de la MéditerranéeAuteur
Le Monde, La Vie ; [contributeurs Christian Grataloup, Daniel Rondeau, Adrien Candiard,... [et al.] ; Chantal Cabé, Michel Lefebvre, éd.Type
livreEditeur
Paris : Le Monde : La Vie, 27/06/2019Collection
Hors-Série ; n°29Nombre de pages
186 p.Prix
12 €Date de publication
26 septembre 2019L’histoire de la Méditerranée
C’est un Hors-Série[1] épique et magnifiquement illustré que Chantal Cabé et Michel Lefebvre ont coordonné en convoquant les meilleurs spécialistes des questions méditerranéennes.
Voici le récit de l’histoire commune, occidentale et orientale, de ce « confetti à l’échelle de la planète où se sont écrites certaines des plus grandes pages de l’Histoire universelle ».
En écho, cet été, aux deux bouts de la France, l’exposition Homère au Louvre-Lens, ainsi qu’une nouvelle présentation de la Galerie de la Méditerranée, au MUCEM de Marseille, en deux volets : Connectivités[2] s’attache aux relations entre grandes cités de l’aire méditerranéenne aux XVIe-XVIIe siècle et au XXIe siècle ; Ruralités[3] explore l’émergence au Néolithique des trois cultures emblématiques de l’agriculture méditerranéenne, la vigne, l’olivier, les céréales.
En introduction aux cinq chapitres de ce copieux et passionnant travail, le géographe Christian Grataloup rappelle que « la mer au milieu des terres » est la mère des continents et des époques, la mère de la cartographie marine occidentale, la ligne de partage entre deux rives, le couchant, l’ouest (Ereb, serait une étymologie possible d’Europe) et le levant, l’est (Assou, Asie), les deux premiers continents désignés. Il se met aussitôt, comme le fait le MUCEM, sous l’égide de l’histoire d’amour de Fernand Braudel, cet historien Lorrain bouleversé par la découverte de la mer Méditerranée, devenue l’héroïne d’une œuvre novatrice.
La culture méditerranéenne existe-t-elle ? Ce questionnement est le titre du premier chapitre – où il est traité du climat, de l’olivier, du vin, des chansons, de la naissance de la philosophie, de la lingua franca et des marins – mais les quatre autres, qui suivent un ordre chronologique, vont aussi contribuer à donner des éléments de réponse, toujours actualisés.
Chaque chapitre commence par l’interview d’une personnalité dont une courte citation formule clairement l’axe. Une double page met en scène chaque fois une figure représentative et un moment clé ayant marqué les mémoires : “Ulysse, un héros très humain” (p. 44-45) et “Il faut détruire Carthage” (p.54-55), “Averroès, philosophe décisif ” (p.80-81) et “La mosquée de Cordoue, une divine conjonction” (p.74-75), “Chypre coupée en deux” (p.118-119) et “Les pieds- noirs : retour en terre inconnue” (p.126-127), “La cuisine méditerranéenne, un savoureux patrimoine” (p.158-159) et “L’Aquarius, sauveteur en mer” (p.166-167).
Dans Source de civilisations, l’écrivain Daniel Rondeau rappelle que « Le triangle Grèce-Judée-Rome est au centre de l’histoire du monde ». Dans l’espace antique euroméditerranéen le brassage entre Orient et Occident a été permanent et le christianisme a joué un rôle central.
Puis Chrétiens et musulmans, le face à face explore les conflits qui, depuis le Moyen-Age, ont vu s’opposer les puissances chrétiennes et musulmanes. « La confrontation permet aussi la connaissance réciproque » nous dit Adrien Candiard, chercheur installé à l’Institut dominicain d’études orientales[4] du Caire. Les trois grands monothéismes sont nés aux marges des empires et la Méditerranée est devenue au fil du temps le lieu de leur rencontre, de leurs échanges et de leur confrontation.
Dans L’Europe à la manœuvre, c’est l’écrivain libanais Charif Majdalani qui introduit la thématique selon laquelle « une part de la culture européenne trouve sa source en Orient ». Elle est explorée dans l’examen des républiques indépendantes italiennes, de Marseille, des trois détroits-verrous stratégiques de la Méditerranée, du canal de Suez, de la géo-politique au XIXe siècle, de la Méditerranée lors de la deuxième guerre mondiale, des projets sans lendemain de partenariat rive Nord/rive Sud.
Enfin Erri de Luca, avec sa passion et son engagement espérant, ouvre la dernière partie, Vents contraires, mer agitée : « En Méditerranée, aucun barrage ne résistera à la force du désespoir », nous dit-il. Les questionnements, les enjeux et les conflits actuels d’Israël et de Palestine, du Liban, de la Corse, des relations gréco-turques, du monde arabe, de la géo-politique, des flux migratoires, de l’environnement et des flux touristiques sont mis en perspective avec clarté et pédagogie.
La voix de l’écrivaine et militante féministe algérienne Wasyla Tamzali clôture cette somme polyphonique : sens de l’hospitalité, lien charnel avec la mer, rapport étroit à la famille, et dialogue nécessaire des deux rives, telle lui apparaît l’identité d’une Méditerranée plurielle « qui doit retrouver la créativité qui illumina l’histoire de l’humanité ». La Méditerranée est aujourd’hui un espace minuscule et insignifiant sur le plan économique, mais sa richesse est ailleurs, dans les mythes, les religions et les histoires produites. Le passé ne fait qu’éclairer l’avenir : « Les signes sont là du réveil des peuples des pays du Sud de la Méditerranée. S’ils ont la possibilité d’être eux-mêmes, ils avanceront vers la liberté. » Car « le monde est rond et tout ce qui se passe dans le Sud de la Méditerranée a et aura des répercussions dans les pays du Nord. »
Une lecture féconde pour faire le point, réfléchir, comprendre et prendre élan pour les actions à venir.
Pascale Cougard
[1] Sommaire : Dans le grand bain de l’Histoire. 1. La culture méditerranéenne existe-t-elle ? 2. Source de civilisations. 3. Chrétiens et musulmans, le face-à-face. 4. L’Europe à la manœuvre. 5. Vents contraires, mer agitée. Grand entretien avec Wassila Tamzali.
[3] Cf. MUCEM-Ruralités