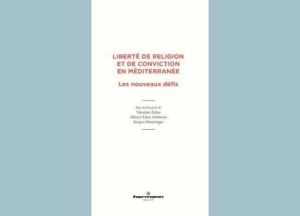Titre
Liberté de religion et de conviction en MéditerranéeSous titre
Les nouveaux défisAuteur
sous la direction de Valentine Zuber, Alberto Fabio Ambrosio, Jacques Huntzinger ; préface d'Abdelmajid CharfiType
livreEditeur
Paris : Hermann : Collège des Bernardins, 2020Collection
Forum des BernardinsNombre de pages
437 p.Prix
23 €Date de publication
28 mai 2022Liberté de religion et de conviction en Méditerranée.
Ce livre est foisonnant autour d’un thème très complexe, le religieux en Méditerranée. Il est le fruit d’une recherche collective qui a duré deux ans dans le cadre du séminaire “Dialogues méditerranéens sur le religieux” du Collège des Bernardins à Paris, et qui s’est achevé par un colloque à Tunis, en septembre 20181. Des chercheurs des deux rives ont tenté de faire le point sur les pratiques historiques et actuelles de la liberté de conscience et de la liberté de religion dans cette région.
Diverses disciplines sont convoquées, histoire, droit, sociologie, théologie, pour examiner la manière dont les libertés individuelles, civiles et religieuses, sont pratiquées dans les différents États méditerranéens. La matière ne manque pas, autant dans la diversité des cultures des citoyens de ces nations que dans une période de grands changements liés à la croissance démographique, la circulation des personnes, l’élévation du niveau de vie, la libération de la femme, etc.
Ce volume est composé de 17 contributions, toutes très fouillées et approfondies, que l’on ne peut pas résumer ici, évidemment. Elles sont regroupées en quatre parties. Une première partie revient sur l’histoire antique, sur le lien entre sciences humaines et liberté de conscience, et sur le droit des femmes et la liberté religieuse. Une deuxième partie comporte six contributions sur le fanatisme, les minorités musulmanes, la sécularisation en Turquie, la liberté religieuse en Grèce, puis en Israël. La troisième partie étudie quelques cas de l’apprentissage de la liberté au Maghreb, notamment en Tunisie et au Maroc. Et la quatrième partie traite de thématiques plus larges, la relation de la religion au politique, la liberté religieuse dans l’Église catholique, et des interrogations sur un nouvel universalisme partagé sur les deux rives de la Méditerranée.
Cet ensemble de contributions est couronné d’une conclusion sur la géopolitique méditerranéenne de la liberté de religion et de conviction, rédigée par Jacques Huntzinger2. Car les religions, on le sait, ne sont pas seulement une affaire de sacristie. Elles sont devenues, dans leur diversité, un moteur de l’histoire et une clé de la géopolitique. Si l’Europe montre une diversité chrétienne largement sécularisée, le sud de la Méditerranée est encore dominé par le discours religieux musulman. Pourtant le Maghreb connaît déjà divers changements dans la liberté de religion, certains pays étant tiraillés entre les sociétés sécularisées et traditionnelles. Le monde de l’Orient connaît par contre “une liberté de conscience en pointillé”.
Le monde méditerranéen apparaît donc divisé en trois régions distinctes que les différentes contributions de ce livre manifestent : d’abord le nord de la Méditerranée, où le droit de la liberté religieuse est confronté à l’irruption de l’islam. Ensuite, le Maghreb où la liberté de religion émerge lentement. Enfin, l’Orient qui reste bloqué dans une cohabitation de religion nationale entre Israël et les pays arabes, le Liban faisant exception avec sa communautarisation du religieux. L’auteur s’interroge sur la possibilité “d’un universalisme modeste”, point de convergence méditerranéen. Il s’agirait, pour ces sociétés, d’accepter l’altérité religieuse au nom de l’affirmation d’un pluralisme. Le Nord peut-il vraiment accepter l’islam comme une religion normale, alors qu’il est souvent marqué par des dominantes catholiques ou orthodoxes ? Et le Sud peut-il accepter l’athéisme et l’apostasie, alors que le monde islamique est globalement dominé par un courant conservateur et fondamentaliste ?
Tous ces équilibres sont extrêmement fragiles, d’autant plus que la religion, porteuse d’absolu, peut conduire à des attitudes radicales.
Concluons ce bref compte rendu en remarquant, à la suite de Jacques Huntzinger, combien nous restons sur le seuil d’une pleine liberté religieuse respectée sur les deux rives de la mer Méditerranée.
Pierre de Charentenay
Institut catholique de la Méditerranée, Marseille (ICM)
Notes de la rédaction
1 Sur ce séminaire et le colloque de Carthage, cf. Les religions de l’espace méditerranéen au défi du pluralisme
2 De Jacques Huntzinger, à lire sur notre site : La Méditerranée existe-t-elle ? (mars 2019) ; Il était une fois la Méditerranée.- CNRS éditions, 2014 ; Initiation à l’islam.- Cerf, 2014 ; et d’autres contributions en notes de la recension de son livre : Le globe et la loi : 5000 ans de relations internationales. Une histoire de la mondialisation.- Cerf, 2019