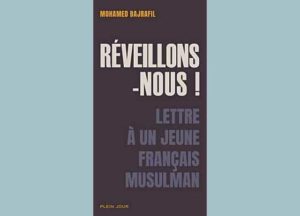Titre
Réveillons-nous !Sous titre
Lettre à un jeune Français musulmanAuteur
Mohamed BajrafilType
livreEditeur
Paris : Plein jour, 2018Nombre de pages
173 pagesPrix
15 €Date de publication
2 juillet 2020Réveillons-nous ! Lettre à un jeune Français musulman
Mohamed Bajrafil poursuit son œuvre et son action pour permettre aux jeunes générations de musulmans de prendre la place qui leur revient dans la société française. Théologien, imam du vendredi à Ivry sur Seine (Val de Marne), il avait publié, en 2015, Islam de France, l’An 11, vigoureux plaidoyer pour que les musulmans déploient leur intelligence et leur raison pour penser et vivre l’islam aujourd’hui en France.
Si le livre est de petit format et se glisse facilement dans une poche, il ne faudrait pas en tirer la conclusion qu’il se lit rapidement ! M. Bajrafil propose ici un chemin de réflexion qui s’appuie sur des références précises du Coran et de la Tradition musulmane. M. Bajrafil fait partie des quelques savants musulmans francophones parmi les plus aptes à aider de jeunes Français musulmans à se situer comme croyants en Dieu et comme participants à la société française. Pourquoi ? Lui-même dispose à la fois d’une formation musulmane traditionnelle reçue dans sa jeunesse aux Comores et d’une pratique des sciences humaines à travers son doctorat en linguistique. Il peut ainsi permettre ce passage d’un islam né dans des sociétés de Tradition à un islam qui se pense et se vit dans la modernité, voire la post-modernité. Car tel est le défi devant lequel sont placés les musulmans vivant en Occident dans des sociétés où ils sont à la fois présents et en situation de minorité (comme d’autres traditions religieuses ou spirituelles).
Il entend donc s’adresser au jeune musulman comme un maître s’adresse à un disciple mais en insistant d’un bout à l’autre de ce livre, comme il l’avait fait dans le précédent, sur le respect de la liberté de son interlocuteur. Son but est clair : « c’est sur les bases même de l’islam que je t’invite à réfléchir, afin de distinguer l’utile du futile, l’essentiel du superflu. (…) Ce livre vise à te réconcilier à la fois avec ton temps et ta religion. » (p. 15).
La première partie de l’ouvrage va donc porter sur la foi qu’il ne cesse de lier avec l’exercice de l’intelligence : « la foi… ne peut être quelque chose qui s’hérite ni qu’on nous impose. Elle cesse dès lors qu’elle n’est pas le fruit de notre effort, de notre intellect. La foi en Dieu doit avoir un minimum de logique. Croire bêtement est un non-sens, une non-foi absolue. » (p. 23). Son propos s’appuie sur de nombreuses références au Coran, aux Hadiths, et aux grands savants de l’islam. Il conclut le premier chapitre en soulignant que la foi en islam ne peut être définie que « comme un acte de liberté par lequel le croyant rompt avec toute soumission à une créature comme lui, y compris à sa propre personne, ses propres passions, pour être en phase avec son Créateur.» (p. 34).
Dans le chapitre suivant, l’auteur entend dénoncer et démonter « l’idéologie takfiriste » qui, pour défendre la foi, entend excommunier tous les musulmans qui ne pensent pas comme les membres de ce courant. Il n’a pas peur d’inscrire dans cette démarche qui cause tant de mal aux musulmans, l’idéologie wahhabite, répandue dans le monde entier par l’Arabie saoudite, grâce aux pétrodollars. Il s’étonne de ces propos de haine qui ne peuvent, selon lui, s’appuyer sur le Coran : « Ouvre le Coran, tu verras partout proclamée cette évidence que le Prophète n’était rien d’autre qu’une miséricorde offerte aux univers. Nier cela, c’est remettre en cause le message.» (p. 43-44). Bajrafil met en garde la nouvelle génération contre ce qu’il appelle la bigoterie, liée à l’ignorance, et appelle les jeunes à un travail : « Il en va de la survie du monde et des êtres, donc de notre religion. » (p. 55).
Partant de là, dans le troisième chapitre, Bajrafil s’attaque à la notion de « mécréance », avec ces mots de « kâfir » ou « kouffar » [mécréant(s)], entendus si souvent dans la bouche de jeunes. Il rappelle que lui-même, dans son passé, a considéré comme mécréant tout ce qui n’était pas musulman. Mais aujourd’hui il écrit aux jeunes : « Le chrétien est ton frère et le mien avant d’être chrétien ; le juif, le mazdéen, le bouddhiste – même les moines birmans qui, récemment, ont participé ou incité aux massacres de leurs frères musulmans -, sont nos frères. » (p. 77). Il faut donc revoir complètement la notion de mécréance. Il conclut cette première partie par une affirmation : « L’islam est ouverture et tous ces gens veulent le fermer. » et un conseil : « Apprends des autres mais réfléchis par toi-même. » (p. 86).
La seconde partie porte sur la pratique de l’islam que la Tradition musulmane appelle le « bon agir » (al Ihsan). M. Bajrafil l’ouvre en résumant ainsi sa 1ᵉ partie : « la place centrale de l’individu. Le message est pour l’homme, pas contre lui. Il a été conçu par Dieu pour le servir et pas pour l’asservir, pour le construire pas pour le détruire. » (p. 91). Dans les objectifs majeurs de la création de l’homme, il y a pour lui la connaissance de son prochain, une connaissance mutuelle. Du coup, il prend le temps d’expliquer l’attitude du prophète de l’islam vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Pour lui, dans le Coran le pardon est toujours supérieur aux accents de vengeance ou de violence qu’on y trouve. A ce sujet, il revendique la liberté d’interprétation : « Libres de comprendre par nous-mêmes la vérité, d’interpréter les textes pour la découvrir. » (p. 113).
Dans la dernière partie du livre, M. Bajrafil revient sur des questions qui touchent à la vie sociale des musulmans avec les autres dans la société d’aujourd’hui, la mixité par exemple. Là encore, il montre que, dans la tradition, on peut trouver des avis divergents et qu’il faut interpréter pour aujourd’hui. Il ironise sur ceux qui n’ont que le mot haram [interdit, péché] à la bouche : « La vie du musulman est en train de tourner au cauchemar. Il y a du péché dans la moindre chose. Même respirer va devenir un problème. » (p. 150).
Enfin, Mohamed Bajrafil plaide pour la réforme, réforme qui doit engager un mouvement de retour vers la spiritualité : « La spiritualité doit reprendre sa place, longtemps confisquée par le fiqh [la jurisprudence] » (p. 162). La conclusion est un appel au jeune musulman : « Invente, crée, innove. Trouve par toi-même les moyens d’aider concrètement à améliorer les conditions de vie des autres. C’est par ce biais seulement que tu pourras espérer renverser la courbe des injustices que tu subis ou vois subir. » (p. 164-165).
Souhaitons que cet appel trouve écho parmi de jeunes adultes musulmans, hommes et femmes. La lecture de ce livre sera aussi utile aux non-musulmans, leur montrant qu’il est possible de l’intérieur de la tradition musulmane, et en s’appuyant sur elle, de poser les jalons d’une Réforme. Dans un contexte bien différent de la fin du XIXᵉ siècle, Mohamed Bajrafil reprend le flambeau du « Réveil » de la Renaissance, « An Nahada », lancée par Mohamed Abdou (1849-1905)2, et bien détournée dans un sens conservateur par une partie de sa descendance.
M. Bajrafil insiste sur le travail qui est à entreprendre : puisse-t-il trouver d’autres savants et imams pour le poursuivre avec eux et permettre ainsi aux musulmans de vivre pleinement leur foi dans la société française, aujourd’hui.
Christophe Roucou
Enseignant à l’Institut Catholique de la Méditerranée – Marseille
Notes de la rédaction
1 Lire, sur notre site, la recension de : Islam de France, L’an I : il est temps d’entrer dans le XXIème siècle / Mohamed Bajrafil.- Plein Jour, 2016
2 Cf. Deux articles sur la Nahda (Réveil, Renaissance) : Nahda, la renaissance arabe / Anne-Laure Dupont.- Le Monde diplomatique : n° de Manière de voir (août-sept. 2009) ; La théologie de la libération de Mohammed Abduh / Mohamed Tahar Bensaada.- Oumma, 15/02/2020